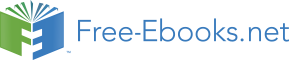Après cet effroyable massacre, les Jacobins réclamèrent avec ardeur la vie du roi Louis XVI. Il fut jugé par la Convention et condamné à être décapité[499].
Décès du Roi Louis XVI et d'autres Membres de la Famille Royale.
Le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI fut décapité publiquement au milieu de sa propre métropole, sur la place Louis Quinze, érigée à la mémoire de son grand-père. Il est possible, pour l'œil critique de l'historien, de découvrir beaucoup de faiblesses dans la conduite de ce monarque malheureux ; car il n'avait ni la détermination de lutter pour ses droits, ni le pouvoir de se soumettre avec une apparente indifférence à des circonstances où la résistance impliquait le danger. Il se soumettait, en effet, mais sans bonne grâce, au point de se faire soupçonner de lâcheté, sans obtenir le crédit d'une concession volontaire. Pourtant, son comportement en de nombreuses occasions éprouvantes le disculpe efficacement de l'accusation de timidité. Il a démontré que son refus de verser le sang, qui le distinguait particulièrement, était dû à la bienveillance et non à la timidité.
Sur l'échafaud, il se comporta avec la fermeté d'un noble esprit et la patience d'un réconcilié avec le ciel. C'est l'un des rares traits de sympathie qui ont adouci ses souffrances.
La présence d'un confesseur, qui n'avait pas prêté le serment constitutionnel, était permise au monarque détrôné. Celui qui assuma cette fonction honorable mais dangereuse était un gentleman de la famille douée d'Edgeworth d'Edgeworthstown. Le zèle dévoué avec lequel il s'acquitta de ses derniers devoirs envers le roi Louis XVI aurait pu, en fin de compte, se révéler fatal pour lui-même. Au moment où l'instrument de mort s'abaissait, le confesseur prononça les mots impressionnants : "Fils de Saint Louis, montez au Ciel !".
Les dernières volontés du roi Louis XVI ont été diffusées de bonne source. Je recommande à mon fils, si vous avez le malheur de devenir roi, de se rappeler que toutes ses facultés sont au service du public. Je recommande à mon fils, s'il a le malheur de devenir roi, de se rappeler que toutes ses facultés sont au service du public, qu'il doit rechercher le bonheur de son peuple en gouvernant selon les lois, en oubliant toutes les blessures et tous les malheurs, et en particulier ceux que j'ai pu subir. Mais tout en l'exhortant à gouverner sous l'autorité des lois, je ne puis qu'ajouter que cela ne sera en son pouvoir que dans la mesure où il sera doté de l'autorité nécessaire pour faire respecter le droit et punir le mal ; et que sans cette autorité, sa situation dans le gouvernement sera plus préjudiciable qu'avantageuse pour l'État."
Pour ne pas mêler le sort de l'illustre victime de la famille royale à l'histoire générale des victimes du règne de la Terreur, il faut mentionner ici la mort du reste de cette illustre maison royale, qui a fermé pour un temps une monarchie qui, à travers trois dynasties, avait conféré soixante-six rois à la France.
On ne peut supposer que la reine puisse survivre longtemps à son mari. Elle avait été le plus grand objet de la détestation révolutionnaire ; en effet, beaucoup étaient disposés à rejeter 340
Le Livre des Martyrs de Foxe
sur Marie-Antoinette, presque exclusivement, la responsabilité des mesures qu'ils considéraient comme contre-révolutionnaires[500].
Les points d'accusation sont si bas et si dépravés qu'ils ne peuvent être évoqués dans ces lignes. Elle dédaigna d'y répondre, mais en appela à toutes celles qui avaient été mères, contre la possibilité même des horreurs qu'on lui imputait. Elle, la veuve d'un roi, la sœur d'un empereur, fut condamnée à mort, traînée dans un tumulus ouvert jusqu'au lieu d'exécution et décapitée le 16 octobre 1793. Elle mourut dans sa 39ème année.
La princesse Élisabeth, sœur du roi Louis, dont on a pu dire, selon les termes de Lord Clarendon, qu'elle ressemblait à une chapelle dans le palais d'un roi. Un sanctuaire où ne peuvent pénétrer que la piété et la moralité, alors que le péché y est omniprésent.
L'oisiveté et la folie n'ont pas échappé, par le comportement le plus inoffensif et le caractère le plus inoffensif, au sort misérable dans lequel les Jacobins avaient résolu d'entraîner toute la famille du roi Louis XVI. Une partie de l'accusation était à l'honneur de son caractère. On lui reproche d'avoir laissé entrer dans les appartements des Tuileries des gardes nationaux, de la section des Filles de Saint Thomas. Elle ordonna que l'on soignât les blessures reçues dans un combat avec les Marsellois, immédiatement avant le 10 août. La princesse avoua son crime et il était exactement conforme à toute sa conduite. Une autre charge énonçait l'accusation ridicule, qu'elle avait distribué aux défenseurs du château des Tuilleries des balles mâchées par elle-même et par ses suivantes, pour les rendre plus meurtrières. C'était une fable ridicule, dont il n'y avait aucune preuve. Elle fut décapitée en mai 1794. Elle fut condamnée à mort de la même manière qu'elle avait passé sa vie.
Nous sommes las de raconter ces atrocités, comme d'autres doivent l'être de les lire. Il n'est pourtant pas inutile que les hommes voient la profondeur de la dégradation de la nature humaine, en contradiction avec tous les sentiments les plus sacrés, avec tous les appels à la justice ou à l'humanité. Nous avons déjà décrit le Dauphin comme un enfant prometteur de sept ans, âge auquel aucune offense n'aurait pu être commise, et dont on ne pouvait appréhender aucun danger. Néanmoins, on résolut de faire périr l'enfant innocent, et par des moyens auxquels les meurtres ordinaires paraissent des actes de miséricorde.
Le malheureux garçon fut confié à la charge du scélérat le plus endurci que comptait la communauté de Paris. Ils connaissaient bien l'emplacement de tels agents et le choisirent parmi leur bande de Jacobins. Ce misérable, un cordonnier du nom de Simon, demanda à ses employeurs : "Que faire du jeune loup de mer ?" "Non ?" "Empoisonné ?" "Non." "Mort de faim ?" "Non." "Que faire alors ?" "Il faut le tuer". "Et alors ?" "Il faut s'en débarrasser." C'est ainsi que, par la poursuite des traitements les plus sévères, par les coups, le froid, les veilles, les jeûnes, les sévices de toutes sortes, une fleur si fragile fut bientôt flétrie. Il mourut le 8
juin 1795.
Après ce dernier crime horrible, il y eut un relâchement en faveur de la fille, et maintenant de l'unique enfant de cette maison condamnée. La princesse royale, dont les qualités ont 341
Le Livre des Martyrs de Foxe
honoré jusqu'à sa naissance et son sang, connut[501] à partir de cette époque une captivité atténuée. Enfin, le 19 décembre 1795, cette dernière relique de la famille du roi Louis, fut autorisée à quitter sa prison et son pays, en échange de La Fayette et d'autres personnes que l'Autriche délivra à cette condition de la captivité. Elle devint ensuite l'épouse de son cousin, le duc d'Angoulême, fils aîné du monarque régnant de France, et obtint, par la manière dont elle se conduisit à Bourdeaux en 1815, les plus grands éloges pour sa bravoure et son esprit.
Scènes Epouvantables en Vendée
En Vendée, l'un des départements français, une insurrection éclate contre le gouvernement jacobin, en 1793.
Plus de deux cents batailles et combats mineurs ont eu lieu dans ce pays dévoué. La fièvre révolutionnaire était à son comble. L'effusion de sang semblait être un plaisir pour les auteurs de massacres. Il était varié par toutes les inventions que la cruauté pouvait inventer pour lui donner un nouvel élan. Les habitations des Vendéens furent détruites, leurs familles soumises à des violations et à des massacres, leurs bestiaux écorchés et abattus, leurs récoltes brûlées et gaspillées. Une colonne républicaine prit et mérita le nom d'Infernale par les horribles atrocités qu'elle commit. A Pilau, ils ont fait rôtir les femmes et les enfants dans un four chauffé. On pourrait raconter d'autres horreurs semblables, si le cœur et la main ne reculaient pas devant la tâche. Sans citer d'autres exemples particuliers d'horreur, nous utilisons les mots d'un témoin oculaire républicain pour exprimer le spectacle général offert par le théâtre du conflit public.
"Je n'ai pas vu un seul homme dans les villes de St. Hermand, Chantonnay ou Herbiers.
Quelques femmes seulement avaient échappé au glaive. Les maisons de campagne, les cottages, les habitations de toute espèce, étaient brûlées. Les troupeaux erraient avec terreur autour de leurs abris habituels, qui fumaient maintenant dans les ruines. J'ai été surpris par la nuit, mais les flammes vacillantes et lugubres de la conflagration éclairaient le pays. Aux bêlements des troupeaux terrifiés et aux mugissements du bétail terrorisé s'ajoutaient les notes rauques et profondes des corbeaux charognards et les hurlements des animaux sauvages venant des recoins des bois pour s'attaquer aux carcasses des tués. Enfin, une colonne de feu lointaine, qui s'élargissait et augmentait à mesure que j'approchais, me servit de balise. C'était la ville de Mortagne en flammes. Lorsque j'y arrivai, on ne voyait plus aucun être vivant, à l'exception de quelques femmes misérables qui s'efforçaient de sauver quelques restes de leurs biens de la conflagration générale."-[Les Mémoires d'un Ancien Administrateur des Armes Républicaines].
Scènes à Marseille et à Lyon
Marseille, Toulon et Lyon s'étaient déclarés opposés à la suprématie jacobine. Ces villes étaient agrandies par leur commerce et leur situation maritime[502], et, dans le cas de Lyon, par leur maîtrise de la navigation intérieure. Les riches marchands et manufacturiers de ces villes prévoyaient l'insécurité totale de la propriété comme une conséquence de leur propre 342
Le Livre des Martyrs de Foxe
ruine, dans le système de spoliation arbitraire et d'assassinat sur lequel était fondé le gouvernement des Jacobins. Mais la propriété, dont ils se préoccupaient, si sa force naturelle est utilisée à temps, aurait pu élever la barrière la plus puissante pour résister à la révolution.
Cependant, après un certain délai, elle peut en devenir la victime impuissante.
Si les riches sont, en temps voulu, généreux de leurs moyens, ils ont le pouvoir de recruter pour leur cause, et comme adhérents, ceux qui font partie des ordres inférieurs. Mais les riches sont égoïstes ; aussi, lorsque les classes pauvres voient leurs supérieurs abattus et désespérés, elles seraient tentées de les considérer comme des objets de pillage. Mais ces actes de compassion doivent être accomplis de bonne heure, sinon ceux qui pourraient se faire les défenseurs les plus actifs de la propriété, conspireront avec ceux qui sont prêts à la piller.
Marseille montre à la fois sa bonne volonté et l'impuissance de ses ressources. Les plus grands efforts de cette ville riche, dont la bande révolutionnaire avait tant contribué à la chute de la monarchie lors de l'attaque des Tuilleries, ne purent équiper qu'une petite armée douteuse d'environ 3 000 hommes. Ils sont envoyés au secours de Lyon. Cette faible armée se précipita sur Avignon, et fut vaincue avec la plus grande facilité, par le général républicain Cartaux, méprisable comme officier militaire, et dont les forces n'auraient pas résisté à un seul engaillement de francs-tireurs vendéens. Marseille reçut les vainqueurs et baissa la tête devant les horreurs qu'il plut à Cartaux, accompagné de deux redoutables jacobins, Barras et Ferron, d'infliger à cette ville florissante. Elle subit les terreurs habituelles de l'épuration jacobine, et on l'appelle provisoirement "la commune sans nom".
Lyon opposa aux révolutionnaires une résistance plus honorable. Cette noble ville était soumise depuis quelque temps à la domination de Chalier, l'un des Jacobins les plus féroces et en même temps l'un des plus extravagants. Il était à la tête d'un club formidable, digne d'être affilié à la société mère, et ambitieux de marcher sur ses traces. Il était soutenu par une garnison de deux régiments révolutionnaires, outre une nombreuse artillerie, et une grande quantité de volontaires, s'élevant à environ dix mille hommes. Ils formaient ce qu'on appelait une armée révolutionnaire. Ce Chalier, était un prêtre apostat, athée, et un élève assidu de l'école de la Terreur. Il avait été procureur (collecteur d'impôts) de la communauté, et avait imposé aux citoyens riches un impôt élevé de six à trente millions de livres. Mais son objectif est de faire couler le sang autant que l'or. Le massacre de quelques prêtres et aristocrates enfermés dans la forteresse de Pierre-Scixe, était un pitoyable sacrifice. Chalier, ambitieux d'actions plus décisives, fit procéder à l'arrestation générale de cent principaux citoyens, qu'il destinait à une hécatombe plus digne du démon qu'il servait.
Ce sacrifice fut empêché par le courage des Lyonnais ; courage qui, s'il avait été assumé par les Parisiens, aurait pu prévenir[503] la plupart des horreurs qui ont déshonoré la révolution. Le massacre médité était déjà annoncé par Chalier au club des Jacobins. "Trois cents têtes, dit-il, sont marquées pour être égorgées. Ne tardons pas à nous emparer des membres des bureaux départementaux, des présidents et secrétaires de sections, de toutes les 343
Le Livre des Martyrs de Foxe
autorités locales qui entravent nos mesures révolutionnaires. Faisons-en un seul fagot et livrons-les immédiatement à la guillotine."
Mais, avant qu'il ne puisse mettre sa menace à exécution, la terreur s'éveilla au courage du désespoir. Les citoyens prirent les armes et assiégèrent l'Hôtel de Ville, dans lequel Chalier, avec ses troupes révolutionnaires, se défendit désespérément et avec succès pendant un certain temps, mais finalement en vain. Malheureusement, les Lyonnais n'ont pas su profiter de leur triomphe. Ils n'étaient pas suffisamment conscients de la nature de la vengeance qu'ils avaient provoquée, ni de la nécessité de soutenir l'audacieuse démarche entreprise par des mesures qui excluaient tout compromis. Leur résistance à la violence et à l'atrocité des Jacobins n'avait aucun caractère politique, pas plus que celle du voyageur contre les brigands qui le menacent de pillage et de meurtre. Ils n'étaient pas assez conscients qu'après avoir fait tant, ils devaient nécessairement faire plus. Ils auraient dû, en se déclarant royalistes, s'efforcer d'amener les troupes de Savoie, sinon les Suisses, (qui avaient embrassé une espèce de neutralité qui, après le 10 août, déshonorait leur ancienne réputation), à envoyer en toute hâte des soldats au secours d'une ville qui n'avait ni fortifications, ni troupes régulières pour la défendre. Elle possédait cependant des trésors pour payer ses auxiliaires, des bras forts et des officiers compétents pour se servir des localités de sa situation, qui, bien fortifiées et défendues, sont parfois aussi redoutables que les protections régulières érigées par les ingénieurs scientifiques.
C'est en vain que les Lyonnais s'efforcent de se donner un caractère révolutionnaire sur le modèle girondin. Deux de ses députés proscrits essayèrent de les rallier à leur cause impopulaire et désespérée ; et ils cherchèrent inconsidérément à se protéger en affichant un zèle républicain, alors même qu'ils résistaient aux décrets et battaient les troupes des Jacobins.
Il y avait sans doute beaucoup de royalistes parmi les insurgés, et certains de leurs chefs l'étaient résolument ; mais ils n'étaient pas assez nombreux ou influents pour établir le vrai principe de la résistance ouverte, et l'ultime chance de sauvetage, par une proclamation audacieuse de l'intérêt du roi. Ils en appelaient encore à la Convention comme à leur souverain légitime, aux yeux duquel ils s'efforçaient de se justifier. En même temps, ils essayaient de s'assurer l'intérêt de deux députés jacobins, qui avaient cautionné toutes les violations tentées par Chalier, afin de les amener à représenter favorablement leur conduite. Bien entendu, ils avaient suffisamment de promesses à cet effet, tant que MM. Guathier et Nioche, les députés en question, restaient en leur pouvoir ; promesses, sans doute, d'autant plus facilement accordées, que les Lyonnais, quoique désireux de se concilier la faveur de la Convention, n'hésitaient pas à procéder au châtiment du jacobin[504] Chalier. Il fut condamné et exécuté, ainsi qu'un de ses principaux associés, nommé « Réard_ ».
Pour défendre cette action vigoureuse, les malheureux insurgés se placèrent sous le gouvernement provisoire d'un conseil qui, voulant toujours temporiser et maintenir le caractère révolutionnaire, s'intitula "Commission populaire et républicaine de sûreté publique du département du Rhin et de la Loire", titre qui, bien qu'il n'excitât aucun enthousiasme populaire et n'attirât aucune aide étrangère, n'apaisa pas, mais au contraire exaspéra le 344
Le Livre des Martyrs de Foxe
ressentiment de la Convention, désormais sous la domination absolue des jacobins. Pour cette société, tout ce qui n'est pas une fraternisation complète est considéré comme un défi présomptueux. Pour ceux qui n'étaient pas de connivence avec eux, leur politique était de les considérer comme leurs ennemis les plus absolus.
En effet, les Lyonnais reçurent des lettres de réconfort, de solidarité et de concours de plusieurs départements, mais aucun soutien effectif ne fut jamais dirigé vers leur ville, à l'exception d'un petit renfort de Marseille. Cette résistance insignifiante, nous l'avons vu, fut interceptée et dispersée sans trop de difficultés par le général jacobin Cartaux.
Lyon s'attendait à devenir la patronne et le centre d'une ligue anti-jacobine, formée par les grandes villes commerçantes, contre Paris et la partie prédominante de la Convention. Elle se retrouve isolée, sans soutien et vulnérable. Elle s'opposa par ses propres forces et moyens de défense, avec une armée de soixante mille hommes et d'innombrables jacobins réfugiés dans ses propres murs. Vers la fin du mois de juillet, après un intervalle de deux mois, un blocus régulier fut formé autour de la ville et, dans la première semaine d'août, les hostilités eurent lieu. L'armée assiégeante était dirigée militairement par le général Kellerman, qui, avec d'autres soldats distingués, avait commencé à occuper un rang éminent dans les armées républicaines. Sauf pour exécuter la vengeance dont ils avaient soif, les Jacobins comptaient surtout sur les efforts des députés qu'ils avaient mandés auprès du commandant, et surtout sur ceux du représentant Dubois Crance. C'est un homme dont le seul mérite semble avoir été son jacobinisme fiévreux et effréné. Le général Percy, ancien officier du service royal, entreprit la tâche presque désespérée de la défense, et en formant des forteresses sur les situations les plus dominantes autour de la ville, il commença une rébellion militaire contre la force immensément supérieure des assiégeants, ce qui était honorable si c'était utile.
Les Lyonnais, en même temps, s'efforçaient encore de se flatter de pouvoir rivaliser avec l'armée assiégeante, en se représentant comme de fermes républicains. Ils célébrèrent comme une fête publique l'anniversaire du 10 août, et Dubois Crance, pour se recommander de leur zèle républicain, fixa au même jour le commencement de son ardente attaque contre la place.
Il fit tirer le premier coup de canon par sa propre concubine, née à Lyon. Ensuite, on fit éclater des bombes et des boulets rouges contre la seconde ville de l'empire français ; tandis que les assiégés soutenaient l'attaque avec constance, et la repoussaient sur plusieurs points avec un courage qui faisait honneur à leur caractère[505]. Mais leur sort était fixé. Les députés annoncèrent à la Convention leur intention d'employer leurs instruments de ravage sur tous les quartiers de la ville à la fois, bombardés en plusieurs endroits, pour provoquer une tempête générale. "La ville, disaient-ils, doit se rendre, ou il ne restera pas une pierre posée sur une autre ; c'est ce que nous espérons accomplir en dépit des suggestions d'une fausse compassion.
Ne vous étonnez donc pas d'apprendre que Lyon n'existe plus." La fureur de l'attaque menace de réaliser ces promesses.
Les souffrances des citoyens deviennent intolérables. Plusieurs quartiers de la ville furent incendiés en même temps. D'immenses usines et bâtiments furent réduits en cendres, et les 345
Le Livre des Martyrs de Foxe
pertes subies pendant les deux nuits de bombardement furent évaluées à deux cents millions de livres. Un drapeau noir fut hissé par les assiégés sur le Grand Hôpital, en signe que le feu des assaillants ne devait pas être dirigé sur cet asile d'une misère sans espoir. Le signal du drapeau ne semblait qu'attirer les bombes républicaines à l'endroit même où elles pouvaient créer les détresses les plus effroyables et outrager au plus haut degré les sentiments de l'humanité. Les ravages de la famine succédèrent bientôt à ceux du massacre. Après deux mois de telles horreurs, il devint évident qu'il était impossible de résister davantage.
Le Comité de salut public envoya à Lyon le paralytique Couthon, avec Collot d'Herbois et d'autres députés, pour prendre la revanche que les Jacobins réclamaient. Dubois Crance fut rappelé pour avoir mis, pensait-on, moins d'énergie dans ses démarches que ne l'exigeait la poursuite du siège. Collot d'Herbois avait un motif personnel d'une nature singulière pour se réjouir de la tâche qui lui avait été confiée ainsi qu'à ses collègues. En tant qu'acteur, il avait été chassé de la scène à Lyon, et la porte de la vengeance était maintenant ouverte. Les instructions de ce comité leur enjoignaient de tirer de la mort de Chalier et de l'insurrection de Lyon la vengeance la plus satisfaisante, non seulement sur les citoyens, mais sur la ville elle-même. Les rues et les édifices principaux devaient être rasés, et un monument érigé à l'endroit où ils se trouvaient devait en indiquer la cause : "Lyon s'est révolté contre la République - Lyon n'est plus." Les fragments de la ville qui pourraient subsister porteraient le nom de "Ville Affranchie". Il est difficile de croire qu'un sort comme celui-là, qui aurait pu être prononcé par quelque despote oriental, dans toute la folie frénétique d'un pouvoir arbitraire et d'une ignorance totale, ait pu être sérieusement prononcé et aussi sérieusement appliqué dans l'une des nations les plus civilisées d'Europe. Il est tout aussi incroyable qu'à notre époque éclairée, des hommes qui prétendent à la sagesse et à la philosophie aient pu considérer les travaux de l'architecte comme un sujet de punition approprié.
Cependant, afin de maximiser l'effet de la démolition, l'impuissant Couthon fut transporté de maison en maison, vouant chacune à la ruine, en frappant la porte avec un marteau d'argent, et en prononçant ces mots : "Maison d'un rebelle. Je te condamne au nom de la loi." Des ouvriers suivaient en[506] grand nombre, qui exécutaient la sentence en arrachant la maison jusqu'aux fondations. Cette démolition gratuite dura six mois, et l'on dit qu'elle fut exécutée à une dépense égale à celle que le superbe hôpital militaire, l'hôtel des Invalides, coûta à son fondateur, le roi Louis XIV. Mais la vengeance républicaine ne s'est pas exclusivement attaquée à la chaux et à la pierre mortes, elle a cherché des victimes vivantes.
La mort méritée de Chalier avait été expiée par une apothéose exécutée après la capitulation de Lyon ; mais Collot d'Herbois déclara que chaque goutte de ce sang patriotique était tombée comme s'il avait ébouillanté son propre cœur, et que le meurtre exigeait une expiation. Toutes les procédures ordinaires, tous les modes d'exécution habituels furent jugés trop tardifs pour venger la mort d'un proconsul jacobin. Les juges de la commission révolutionnaire étaient épuisés de fatigue, le bras du bourreau était las, l'acier même de la 346
Le Livre des Martyrs de Foxe
guillotine était émoussé. Collot d'Herbois imagina un mode de massacre plus sommaire. Un nombre de deux cents à trois cents victimes à la fois étaient traînées de la prison à la place de Baotteaux, l'une des plus grandes places de Lyon, et y étaient soumises à un tir de grenaille (bombes de raisin). Bien que ce mode d'exécution puisse sembler efficace, il n'était ni rapide ni miséricordieux.
Les victimes tombèrent au sol comme des mouches brûlées, mutilées mais non tuées, et implorant leurs bourreaux de les expédier rapidement. Cela fut fait avec des sabres et des baïonnettes, et avec une telle hâte et un tel zèle que certains des geôliers et leurs assistants furent tués en même temps que ceux qu'ils avaient aidé à traîner jusqu'à la mort. On ne s'aperçut de l'erreur que lorsqu'en comptant les cadavres, les militaires assassins s'aperçurent qu'ils étaient plus nombreux que prévu. Les corps des morts furent jetés dans le Rhône, pour communiquer à Toulon la nouvelle de la vengeance républicaine, selon l'expression de Collot d'Herbois - d'autant plus que Toulon s'était également proclamé en état de révolte. Mais le fleuve morose refuse le devoir imposé, et les cadavres reviennent en tas sur les rives. Le Comité des représentants est finalement contraint d'autoriser l'enterrement des vestiges de leur cruauté pour éviter les risques de contagion.
L'Installation de la Déesse de la Raison.
Finalement, le zèle des athées exaspérés de France les poussa à perpétrer l'une des transactions les plus ridicules et en même temps les plus impies qui aient jamais déshonoré les annales d'une nation. Il s'agissait ni plus ni moins d'une renonciation formelle à l'existence d'un Être suprême et de l'installation de la déesse de la Raison, en 1793.
"Il y a, dit Scott, un fanatisme de l'athéisme, aussi bien que de la superstition. Un philosophe peut nourrir et exprimer autant de malveillance contre ceux qui persévèrent à croire ce qu'il lui plaît de dénoncer comme indigne de foi, qu'un prêtre ignorant et bigot contre un homme qui ne peut accorder sa foi à un dogme qu'il croit insuffisamment prouvé." En conséquence, le trône étant[507] totalement anéanti, il sembla aux philosophes de l'école d'Hébert, (auteur du journal périodique le plus grossier et le plus bête de l'époque, appelé _le Père Duchesne_) qu'en détruisant totalement ces vestiges de religion et de culte public que chérissait encore le peuple de France, il s'ensuivrait un splendide triomphe des opinions libérales. "Il ne suffisait pas, disaient-ils, qu'une nation régénérée ait détrôné les rois terrestres, si elle n'étendait pas le bras de la défiance contre les puissances surnaturelles que la superstition avait représentées comme régnant sur l'espace infini.
Un malheureux, nommé Gobet, évêque constitutionnel de Paris, fut contraint de jouer le rôle principal dans la moquerie la plus impudente et la plus scandaleuse qui ait jamais été jouée devant une représentation nationale.
On dit que les responsables de la scène eurent quelque difficulté à amener l'évêque à se conformer à la tâche qui lui était assignée et qu'il exécuta, non sans larmes et sans remords par la suite. Mais il a joué le rôle qui lui était assigné. Il fut transporté en cortège pour déclarer 347
Le Livre des Martyrs de Foxe
à la Convention que la religion qu'il avait enseignée pendant tant d'années, à tous égards, ne constituait qu'un peu de sacerdoce, qui n'avait aucun fondement ni dans l'histoire, ni dans la vérité sacrée. Il renonça, en termes solennels et explicites, à l'existence de la divinité au culte de laquelle il avait été consacré, et se consacra à l'avenir à l'hommage de la liberté, de l'égalité, de la vertu et de la moralité. Il déposa sur la table ses décorations épiscopales et reçut l'accolade fraternelle du président de la Convention. Plusieurs prêtres apostats suivirent l'exemple de ce prélat.
L'or et l'argenterie des églises sont saisis et profanés. Des cortèges de parade sont entrés dans la Convention, vêtus d'habits sacerdotaux ridicules. Ils chantaient les hymnes les plus profanes. Chaumette et Hébert utilisèrent de nombreux calices religieux et vases sacrés pour célébrer leurs propres orgies impies. Pour la première fois, le monde entier a entendu une assemblée d'hommes, nés et éduqués dans la civilisation, s'approprier le droit de gouverner l'une des meilleures nations européennes. Ils élevèrent leur voix unie pour rejeter la vérité la plus solennelle que l'âme de l'homme reçoive. Ils renoncèrent unanimement à la croyance et au culte d'une divinité. Pendant un court laps de temps, la même folie profane s'est poursuivie.
L'une des cérémonies de cette époque insensée n'a pas son pareil pour ce qui est de l'absurdité et de l'impiété. Les portes de la Convention ont été ouvertes à un groupe de musiciens, précédés par les membres du corps municipal qui sont entrés en procession solennelle, en chantant un hymne à la liberté. Ils escortaient, comme objet de leur futur culte, une femme voilée, qu'ils appelaient "la Déesse de la Raison". Transportée en grande pompe dans la salle de la Convention nationale, elle fut dévoilée et placée à la droite du Président.
Elle fut alors généralement reconnue comme une danseuse de l'Opéra, dont la plupart des personnes présentes connaissaient les charmes depuis son apparition sur scène. Alors que l'expérience d'autres personnes avec elle était plus avancée. C'est à cette personne, comme la[508] plus belle représentante de la Raison qu'elle vénérait, que la Convention nationale de France rendit un hommage public.
Cette momerie impie et ridicule eut une certaine vogue ; et l'installation de la déesse de la Raison fut renouvelée et imitée dans toute la nation, dans les lieux où les habitants voulaient se montrer à la hauteur de toutes les hauteurs de la révolution. Dans la plupart des régions de France, les églises furent fermées aux prêtres et aux fidèles, les cloches furent brisées et jetées au canon. Tout l'établissement ecclésiastique fut détruit. L'inscription républicaine sur les cimetières déclarait que la mort était un sommeil perpétuel et annonçait à ceux qui vivaient sous cette domination qu'ils n'espéraient aucune récompense ni aucun remède, même dans l'autre monde.
Intimement liée à ces lois affectant la religion, celle qui réduisait l'union du mariage, l'engagement le plus sacré que les êtres humains puissent former, et dont la permanence conduit le plus fortement à la consolidation de la société, à l'état d'un simple contrat civil de caractère transitoire. En vertu de cet accord, deux personnes peuvent s'engager et jouir des plaisirs jusqu'à ce que leur goût change ou que leur appétit soit satisfait. Si des démons 348
Le Livre des Martyrs de Foxe
s'étaient mis au travail pour découvrir un moyen de détruire le plus efficacement possible tout ce qui est vénérable, gracieux ou permanent dans la vie domestique, et d'obtenir en même temps l'assurance que le mal qu'ils voulaient créer se perpétuerait d'une génération à l'autre, ils n'auraient pas pu inventer un plan plus efficace que la dégradation du mariage. Il s'est transformé en un simple état de cohabitation occasionnelle, ou de concubinage autorisé.
Sophie Arnoult, une actrice célèbre pour ses mots d'esprit, a décrit le mariage républicain comme le sacrement de l'adultère.
Chute de Danton, Robespierre, Marat et Autres Jacobins.
Ces monstres tombaient victimes des mêmes moyens qu'ils avaient utilisés pour la ruine des autres. Marat fut poignardé en 1793 par Charlotte Corday, une jeune femme qui avait nourri, dans un sentiment entre la folie et l'héroïsme, l'ambition de débarrasser le monde d'un tyran. Danton est guillotiné en 1794. Robespierre suivit peu après. Sa chute est ainsi décrite par Scott dans sa Vie de Napoléon.
Enfin, son destin l'a poussé à la rencontre. Robespierre descendit à la Convention, où il n'était apparu que rarement ces derniers temps, comme le dictateur de Rome, bien plus noble.
Dans son cas également, une bande de sénateurs était prête à poignarder le tyran sur place, s'ils n'avaient pas été effrayés par sa prétendue popularité, qui, craignaient-ils, pourrait les rendre instantanément victimes de la vengeance des Jacobins. Le discours que Robespierre adressa à la Convention était aussi menaçant que le premier bruissement lointain d'un ouragan, aussi sombre et lugubre que l'éclipse qui en annonce l'approche. Des murmures angoissés s'étaient fait entendre parmi la population qui remplissait les tribunes ou se pressait à l'entrée de la salle de la Convention. Le bruit courait qu'un second cycle du 31 mai (jour où les Jacobins[509] avaient proscrit les Girondins) serait témoin d'un événement semblable.
Le premier thème de l'orateur lugubre est la mise en scène de ses propres vertus et de ses services en tant que patriote. Il désigne comme ennemis de la République tous ceux dont les opinions sont contraires aux siennes. Il passe ensuite successivement en revue les différents services du gouvernement et les accable de blâmes et de mépris. Il déclame contre la léthargie des comités de salut public et de sûreté publique, comme si la guillotine n'avait jamais été en exercice. Il accuse le Comité des finances d'avoir contre-révolutionné les revenus de la république. Avec non moins d'amertume, il sermonne sur le retrait des artilleurs (toujours de violents jacobins) de Paris, et sur le mode de gestion adopté dans les pays conquis de la Belgique. On eût dit qu'il voulait recueillir les mêmes listes de tous les fonctionnaires de l'Etat, et dans le même souffle les défier tous.
L'un d'entre eux fait la motion d'honneur habituelle pour l'impression du discours, mais c'est alors que la tempête d'opposition éclate. Plusieurs orateurs demandèrent avec véhémence qu'avant d'adopter le discours et ses graves inculpations, on le renvoyât aux deux comités.
Robespierre, à son tour, s'écria que cette mesure soumettrait son discours à la critique partielle et à la révision des partis mêmes qu'il avait accusés. De tous côtés, on entendit des excuses et 349
Le Livre des Martyrs de Foxe
des défenses contre l'accusation qui avait été portée. De nombreux députés se plaignirent en termes non équivoques d'une tyrannie individuelle et d'une conspiration qui circulait pour mettre hors la loi et assassiner les segments opposés de la Convention. Robespierre n'était que faiblement soutenu, sauf par Saint-Just, Couthon et son propre frère. Après un débat orageux, au cours duquel la Convention fut tour à tour animée par la crainte et la haine de Robespierre, le discours fut finalement renvoyé aux comités, au lieu d'être imprimé ; et le dictateur, hautain et maussade, vit dans l'affront ainsi fait à ses mesures et à ses opinions, la marque certaine de sa chute prochaine.
Il transféra ses plaintes au Club des Jacobins, pour reposer, comme il le disait, ses chagrins patriotiques dans leurs vertueuses poitrines, où il espérait seulement trouver du secours et de la sympathie. A cette audience partielle, il renouvela, sur un ton encore plus audacieux, les plaintes dont il avait chargé toutes les branches du gouvernement et le corps représentatif lui-même. Il leur rappela diverses époques héroïques, où leur présence et leurs piques avaient décidé des votes des députés tremblants. Il leur a rappelé leurs actions primitives de vigueur révolutionnaire - leur a demandé s'ils avaient oublié le chemin de la Convention. Il conclut en les assurant pathétiquement que s'ils l'abandonnaient, "il se résignait à son sort, et qu'ils soient témoins du courage avec lequel il boirait la ciguë fatale". L'artiste David l'attrapa par la main au moment où il fermait, s'exclamant, ravi de son élocution : "Je la boirai avec vous."
On a reproché à ce peintre distingué d'avoir, le lendemain, décliné l'engagement qu'il semblait embrasser avec tant d'empressement[510] ; mais il y avait beaucoup de gens qui partageaient son opinion première, au moment où il l'exprimait avec tant d'audace. Si Robespierre avait eu des talents militaires, ou même un courage décidé, rien ne l'aurait empêché de se mettre, cette nuit même, à la tête d'une insurrection désespérée des Jacobins et de leurs adhérents.
Payan, le successeur d'Hébert, proposa même que les Jacobins marchent instantanément contre les deux comités, que Robespierre accusait d'être le centre des machinations antirévolutionnaires, (qu'ils) surprennent leur poignée de gardes, et étouffent le mal dont l'État était menacé, même dans son berceau. Ce plan fut jugé trop hasardeux pour être adopté, bien qu'il s'agisse d'un de ces coups de maître et soudains que Machiavel aurait recommandé. Le feu des Jacobins s'épuisa en tumultes, en menaces, et en expulsant du sein de leur société Collot d'Herbois, Tallien, et une trentaine d'autres députés du parti montagnard, qu'ils considéraient comme spécialement ligués pour provoquer la chute de Robespierre, et qu'ils chassèrent de leur société par l'exécration et même par les coups.
Collot d'Herbois, ainsi outragé, passa directement de la réunion des Jacobins à celle du Comité de salut public, en consultation sur le rapport à faire le lendemain à la Convention sur le discours de Robespierre. Saint Just, l'un des leurs, bien que chaudement attaché au dictateur, avait été chargé de la tâche délicate de rédiger ce rapport. C'était un pas vers la réconciliation
; mais l'entrée de Collot d'Herbois, affolé par les injures qu'il avait reçues, rompit tout espoir 350
Le Livre des Martyrs de Foxe
d'accommodement entre les amis de Danton et ceux de Robespierre. D'Herbois s'épuisa en menaces contre Saint-Just, Couthon et leur maître Robespierre, et ils se séparèrent en termes d'inimitié mortelle et avouée. Les conspirateurs associés mirent tout en œuvre pour s'opposer au pouvoir de Robespierre, pour rassembler et combiner contre lui toutes les forces de la Convention, pour inspirer aux députés de la plaine des craintes pour eux-mêmes et pour réveiller la rage des montagnards, contre la gorge desquels le dictateur brandissait maintenant l'épée que leur politique à courte vue lui avait mise entre les mains. On fit circuler des listes de députés proscrits, copiées sur les tablettes du dictateur ; vraies ou fausses, elles obtinrent un crédit et une monnaie universels. Ceux dont les noms figuraient sur les funestes parchemins, s'engagèrent pour leur protection dans la ligue contre leur ennemi. L'opinion selon laquelle la chute de Robespierre était imminente se généralisa.
Ce sentiment était si répandu à Paris le 9 thermidor, ou 27 juillet, qu'un groupe d'environ quatre- vingts victimes, qui étaient sur le point d'être traînées à la guillotine, a failli être sauvé grâce à lui. Le peuple, dans un généreux élan de compassion, commença à se rassembler en foule, et interrompit le mélancolique cortège, comme si le pouvoir qui présidait à ces hideuses exhibitions était déjà privé d'énergie. Mais l'heure n'était pas venue. Le vil Henriot, commandant de la garde nationale, approché avec de nouvelles forces[511] aussi le jour destiné à être le dernier de sa propre vie, se montra le moyen de mener à l'exécution cette foule de personnes condamnées, mais sans doute innocentes.
Ce jour-là, Robespierre arriva à la Convention, et vit la montagne en ordre serré et complètement occupée, tandis que, comme dans le cas de Catiline, le banc sur lequel il avait l'habitude de s'asseoir, semblait délibérément désert. Saint-Just, Couthon, Le Bas (son beau-frère) et Robespierre le jeune, étaient les seuls députés de nom qui se tenaient prêts à le soutenir. Mais s'il parvenait à lutter efficacement, il pourrait compter sur l'aide du servile Barrère, sorte de Bélial de la Convention. Ce dernier était le plus méchant, mais non le moins habile, de ces esprits déchus qui, avec beaucoup d'habileté et d'ingéniosité, ainsi que d'esprit et d'éloquence, profitaient des occasions qui se présentaient. Il était éminemment adroit, toujours du côté le plus fort et le plus sûr. Il y avait un groupe assez nombreux prêt, en des temps si dangereux, à s'attacher à Barrère, comme à un chef qui prétendait les guider vers la sécurité, sinon vers l'honneur. C'est l'existence de ce corps vacillant et incertain, dont les mouvements ultimes ne pouvaient jamais être calculés, qui rendait impossible de prévoir avec assurance l'événement de tout débat à la Convention pendant cette période dangereuse.
Saint-Just se leva, au nom du Comité de salut public, pour faire, à sa manière et non à la leur, un rapport sur le discours de Robespierre dans la soirée précédente. Il avait commencé une harangue sur le ton de son patron, déclarant que, si la tribune qu'il occupait, la roche Tarpéienne elle-même, il n'en remplirait pas moins les devoirs d'un patriote. "Je suis sur le point, dit-il, de soulever le voile... Je le déchire, dit Tallien en l'interrompant. "L'intérêt public est sacrifié par des individus qui viennent ici exclusivement en leur nom, et qui se conduisent 351
Le Livre des Martyrs de Foxe
comme supérieurs à toute la Convention." Il fait descendre Saint-Just de la tribune, et il s'ensuit un violent débat.
Billaud Varennes attire l'attention de l'assemblée sur la séance du club des Jacobins de la veille. Il déclara la force militaire de Paris soumise au commandement d'Henriot, traître et parricide, prêt à faire marcher les soldats contre la Convention. Il dénonça Robespierre lui-même comme un second Catiline, habile autant qu'ambitieux, dont le système avait été d'entretenir les jalousies et d'embastiller les factions hostiles de la Convention, afin de désunir les partis, d'aliéner les individus les uns contre les autres, de les attaquer en détail, et de détruire ainsi séparément ces antagonistes, sur la force combinée et unie desquels il n'osait rivaliser.
La Convention applaudit à tout rompre l'expression véhémente de l'orateur. Lorsque Robespierre s'élança à la tribune, sa voix fut noyée dans un cri général de "A bas le tyran !", c'est-à-dire "Que ce tyran tombe..." Tallien proposa la dénonciation de Robespierre, l'arrestation d'Henriot, de ses officiers d'état-major et de tous ceux qui étaient mêlés aux violences méditées contre la Convention. Il prit la responsabilité de diriger l'attaque contre le tyran[512], dit-il, et de le poignarder dans la Convention même, si les membres ne montraient pas assez de courage pour appliquer la loi contre lui. A ces mots, il brandit un poignard dégainé, comme s'il était sur le point de réaliser le dessein qu'il s'était proposé. Robespierre lutta encore avec difficulté pour obtenir une audience, mais la tribune fut attribuée à Barrère
; et le parti pris contre le dictateur déchu par cet homme d'État versatile et intéressé, fut le signe le plus absolu que son renversement était irrémédiable. De tous les coins de la salle, on lança des torrents d'invectives contre celui dont un seul mot avait coutume de faire taire la salle.
Cette scène était épouvantable, mais elle n'était pas sans utilité pour ceux qui étaient disposés à la considérer comme une crise extraordinaire, dans laquelle les passions humaines s'affrontaient d'une manière si singulière. Les voûtes de la salle retentissaient des exclamations de ceux qui avaient été jusqu'alors les complices, les flatteurs, les partisans, du moins les avocats timides et effrayés du démagogue détrôné. Lui-même essoufflé, écumant, épuisé, comme le chasseur de l'antiquité classique sur le point d'être maîtrisé et mis en pièces par ses propres chiens, tentait en vain d'élever sa voix criarde de hibou, par laquelle la Convention avait été autrefois terrifiée et réduite au silence. Il demanda au président de l'Assemblée d'entendre les différents partis qui la composaient. Rejeté par les montagnards, ses anciens associés, qui étaient maintenant à la tête de la protestation contre lui, il s'adressa aux Girondistes, si peu nombreux et si faibles qu'ils fussent, et aux députés de la plaine, plus nombreux, mais tout aussi impuissants, chez lesquels ils s'abritaient. Les premiers reculèrent devant lui avec un dégoût méprisant, les seconds avec horreur. En vain, il rappelle aux individus qu'il a épargné leur vie, alors qu'ils étaient à sa merci. Cela aurait pu s'appliquer à tous les membres de la Chambre, à tous les hommes de France ; car qui, pendant deux ans, a vécu autrement qu'avec l'autorisation de Robespierre ? Il devait regretter profondément la 352
Le Livre des Martyrs de Foxe
clémence, comme il pouvait l'appeler, qui avait laissé tant de gens avec des gorges non coupées pour aboyer contre lui. Mais ses appels agités et répétés furent repoussés par certains avec indignation, par d'autres avec un silence maussade, embarrassé et timide.
Un historien britannique pourrait dire que même Robespierre aurait dû être entendu dans sa défense, et qu'un tel calme aurait fait honneur à la Convention, et aurait donné de la dignité à leur sentence finale de condamnation. En réalité, ils ont sans doute traité le coupable selon ses mérites. Ils n'en ont pas moins manqué à la régularité et à la formalité virile de conduite qui leur était due et qui était due à la loi. Cette attitude aurait donné au châtiment du démagogue l'effet et le poids d'une sentence solennelle et délibérée, au lieu d'avoir l'apparence du résultat de la saisie hâtive et précipitée d'un avantage temporaire.
Cependant, la précipitation était nécessaire, et a dû paraître plus importante dans une telle crise qu'elle ne l'était peut-être en réalité. Il faut pardonner en grande partie aux terreurs du moment, au caractère horrible du coupable et à la nécessité de se hâter vers une conclusion décisive. On nous a dit que ses dernières paroles audibles, luttant contre les exclamations de centaines de personnes, et la cloche que le président faisait sonner sans cesse[513], avaient été prononcées dans les tons les plus élevés que le désespoir pouvait donner à une voix naturellement stridente et discordante, sont restées longtemps dans la mémoire, et ont hanté les rêves de beaucoup de ceux qui l'ont entendu : "Président des assassins," cria-t-il, "pour la dernière fois, je demande le privilège de la parole !" Après cet effort, sa respiration devint ponctuelle, courte et faible ; et tandis qu'il prononçait encore des murmures brisés et des éjaculations rauques, les membres de la Montagne crièrent que le sang de Danton étouffait sa voix.
Le tumulte se termina par un décret d'arrestation contre Robespierre, son frère, Couthon et Saint- Just ; Le Bas fut inclus de son propre chef, et, en effet, il aurait difficilement pu échapper au sort de son beau-frère, bien que sa conduite, à ce moment-là et par la suite, ait montré plus d'énergie que celle des autres. Couthon, serrant dans son sein l'épagneul sur lequel il avait coutume d'épuiser le trop-plein de sa sensibilité affectée, en appela à sa décrépitude, et demanda si, mutilé de proportion et d'activité comme il l'était, on pouvait le soupçonner de nourrir des projets de violence ou d'ambition. "Malheureux, dit Legendre, tu as la force d'Hercule pour perpétrer le crime". Dumas, président du tribunal révolutionnaire, Henriot, commandant de la garde nationale, et d'autres complices flagorneurs de Robespierre, furent compris dans la sentence d'arrestation.
La Convention avait déclaré sa séance permanente et avait pris toutes les précautions nécessaires pour demander la protection de la grande masse des citoyens qui, épuisés par le règne de la Terreur, désiraient le fermer à tout prix. Ils reçurent rapidement des députations de plusieurs sections voisines, déclarant leur adhésion aux représentants nationaux, pour la défense desquels ils s'armaient, et (beaucoup sans doute préparés à l'avance) marchaient en toute hâte vers la protection de la Convention. Mais ils apprirent aussi une nouvelle moins réjouissante : Henriot, après avoir dispersé les citoyens qui avaient empêché, comme nous 353
Le Livre des Martyrs de Foxe
l'avons dit, l'exécution des quatre-vingts condamnés, et accompli ce dernier acte de meurtre, s'approchait des Tuilleries, où ils avaient tenu leur séance, avec un nombreux état-major et les forces jacobines qui avaient pu être rassemblées à la hâte.
Heureusement pour la Convention, ce commandant de la garde nationale, de la présence d'esprit et du courage duquel dépendait peut-être le sort de la France, était aussi stupide et lâche qu'il était brutalement féroce. Sans résistance, il se laissa arrêter par quelques gens d'armes, gardes immédiats de la Convention, ayant à leur tête deux de ses membres, qui se conduisirent dans l'urgence avec autant de prudence que d'esprit.
Mais la Fortune, ou le démon qu'il avait servi, offrit à Robespierre une autre chance de sécurité, peut-être même d'empire. Les moments qu'un homme de sang-froid aurait pu utiliser pour s'échapper, un homme de courage désespéré aurait pu les utiliser pour remporter la victoire, qui, compte tenu de l'état divisé et extrêmement instable de la capitale, était susceptible d'être remportée par le concurrent le plus audacieux.
Les députés arrêtés avaient été transportés d'une prison à l'autre, tous les geôliers refusant de recevoir sous leur responsabilité officielle Robespierre[514] et ceux qui l'avaient aidé à fournir à leurs sombres habitations une telle marée d'habitants successifs. Enfin les prisonniers furent mis en sûreté dans le bureau du Comité de salut public. Mais à ce moment, tout était en alarme dans la commune de Paris, où Fleuriot, le maire, et Payan, le successeur d'Hébert, convoquèrent le corps civique, dépêchèrent des officiers municipaux pour soulever la ville et les Fauxbourgs en leur nom, et firent sonner le tocsin. Payan rassembla rapidement une force suffisante pour libérer Henriot, Robespierre et les autres députés arrêtés, et pour les conduire à l'Hôtel de Ville, où environ deux mille hommes étaient rassemblés, consistant principalement en artilleurs et en insurgés du faubourg Saint-Antoine, qui avaient déjà exprimé leur résolution de marcher contre la Convention. Mais le caractère égoïste et lâche de Robespierre n'était pas préparé à une telle crise. Il paraissait tout à fait déconcerté et accablé par ce qui s'était passé et se passait autour de lui ; et de toutes les victimes du règne de la Terreur, aucune ne ressentit aussi complètement que lui, le despote qui avait si longtemps présidé au régime, l'influence invalidante qu'il exerçait. Il n'eut pas, quoiqu'il en eût les moyens, la présence d'esprit de disperser l'argent en sommes considérables, ce qui n'eût pas manqué de lui assurer l'appui de la populace révolutionnaire.
Pendant ce temps, la Convention continuait à maintenir la fa cade audacieuse et imposante qu'elle avait soudainement adoptée de façon critique. Ayant appris l'évasion des députés arrêtés et la nouvelle de l'insurrection à l'Hôtel de Ville, elle adopta instantanément un décret mettant Robespierre et ses associés hors la loi, infligeant un sort similaire au maire de Paris, au procureur et à d'autres membres de la commune, et chargeant douze de ses membres, les plus audacieux qui puissent être choisis, de procéder avec la force armée à l'exécution de la sentence. Les tambours des gardes nationales battaient alors aux armes dans toutes les sections soumises à l'autorité de la Convention, tandis que le tocsin continuait à appeler à l'aide, de sa voix de fer, Robespierre et les magistrats civiques. Tout semblait 354
Le Livre des Martyrs de Foxe
menacer d'une catastrophe violente, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive clairement que la voix publique, et surtout celle des gardes nationaux, se déclarait généralement contre les terroristes.
L'Hôtel de Ville était entouré par environ quinze cents hommes et des canons tournaient sur ses roues. La force des assaillants était la plus faible en nombre, mais leurs chefs étaient des hommes d'esprit, et la nuit dissimulait leur infériorité de force.
Les députés mandatés à cet effet ont lu le décret de l'assemblée à ceux qu'ils ont trouvés rassemblés devant l'hôtel de ville et qui ont reculé devant la tentative de le défendre, certains rejoignant les assaillants, d'autres déposant les armes et se dispersant. Pendant ce temps, le groupe déserté de terroristes à l'intérieur se comportait comme des scorpions qui, lorsqu'ils sont entourés d'un cercle de feu, retournent leurs dards les uns contre les autres et contre eux-mêmes. Des censures mutuelles, féroces et brutales se produisaient parmi ces hommes misérables. "Misérable, est-ce là les moyens que tu avais promis de fournir ?" dit Payan à Henriot, qu'il trouva[515] enivré et incapable de résolution ou d'effort ; et le saisissant en même temps qu'il parlait, il précipita le général révolutionnaire du haut d'une fenêtre. Henriot ne survécut à la chute que pour se traîner dans un égout, dans lequel il fut ensuite découvert et hissé pour être exécuté.
Le jeune Robespierre se jeta par la fenêtre, mais n'eut pas la chance de périr sur place. Il semblait que même le destin mélancolique du suicide, dernier refuge de la culpabilité et du désespoir, était refusé à des hommes qui avaient si longtemps refusé toute forme de pitié à leurs semblables. Le Bas seul eut assez de calme pour se supprimer d'un coup de pistolet.
Saint-Just, après avoir imploré ses camarades de le tuer, attenta à sa vie d'une main irrésolue, et échoua. Couthon, étendu sous la table, brandissait un couteau, avec lequel il lui blessa plusieurs fois la poitrine, sans oser y mettre assez de force pour l'atteindre au cœur. Leur chef, Robespierre, en essayant en vain de se tirer une balle, ne s'était infligé qu'une horrible fracture à la mâchoire inférieure.
Dans cette situation, ils ressemblaient à des loups dans leur tanière, souillés de sang, mutilés, désespérés, mais incapables de mourir. Robespierre gisait sur une table dans une antichambre, la tête soutenue par une boîte et son visage hideux à moitié caché par un tissu sanglant et sale attaché autour du menton brisé.
Les captifs furent transportés en triomphe à la Convention, qui, sans les admettre au barreau, ordonna leur exécution immédiate en tant que hors-la-loi. Lorsque les voitures fatales passèrent à la guillotine, ceux qui les remplissaient, mais surtout Robespierre, furent accablés d'exécrations par les amis et les parents des victimes qu'il avait envoyées sur la même route mélancolique. La nature de sa blessure précédente, dont le tissu n'avait jamais été enlevé avant que le bourreau ne l'arrache, ajoutait à la torture de celui qui souffrait. La mâchoire brisée tombait et le malheureux hurlait à haute voix, au grand effroi des spectateurs. Un masque tiré de cette tête épouvantable fut longtemps exposé dans différents pays d'Europe et consternait le spectateur par sa laideur - le mélange d'expression diabolique et d'agonie corporelle.
355
Le Livre des Martyrs de Foxe
Ainsi tomba Maximilien Robespierre, après avoir été le premier personnage de la République française pendant près de deux ans, au cours desquels il la gouverna selon les principes de Néron ou de Caligula. Son accession à la position qu'il occupait comportait plus de contradictions que n'en comporte peut-être aucun événement similaire dans l'histoire. Un tyran de basse naissance et de faible envergure fut autorisé à gouverner avec la verge du despotisme le plus effrayant un peuple dont le désir de liberté l'avait peu de temps auparavant rendu incapable de supporter le règne d'un souverain humain et légitime. Un lâche ignoble s'éleva à la tête d'une des nations les plus courageuses du monde. C'est sous les auspices d'un homme qui osait à peine tirer un coup de pistolet que les plus grands généraux de France ont commencé leur carrière de conquête. Il n'avait ni éloquence ni imagination ; il leur substitua un style misérable, affecté, ampoulé, qui, jusqu'à ce que d'autres circonstances lui donnassent de l'importance, attira le ridicule général.
Cependant, contre un si pauvre orateur, toute l'éloquence des Girondins philosophes, toute la puissance terrible de son associé Danton, employée[516] dans une assemblée populaire, ne put leur permettre d'opposer une résistance efficace. Il peut sembler insignifiant de mentionner que, dans une nation où les manières aimables et la beauté de l'apparence extérieure excitent beaucoup de prépositions, la personne qui s'est élevée au plus haut pouvoir n'était pas seulement de mauvaise apparence, mais singulièrement mesquine dans sa personne, maladroite et contrainte dans son discours. Il ignorait comment plaire aux autres, même lorsqu'il était le plus enclin à leur donner du plaisir, et il était aussi ennuyeux et fastidieux qu'il était odieux et sans cœur.
Pour compenser toutes ces carences, Robespierre avait une ambition insatiable, fondée sur une vanité qui lui faisait croire qu'il était capable d'occuper les plus hautes fonctions. Cette aspiration prépondérante lui donnait donc de l'audace, alors qu'oser équivaut souvent à réaliser. Il mêlait une espèce de composition ampoulée, fausse, mais plutôt fluide, à la flatterie la plus grossière à l'égard des classes les plus basses du peuple.
En dépit de ses discours mielleux, ils ne pouvaient que recevoir comme authentiques les louanges qu'il s'adressait toujours à lui-même. Sa résolution prudente de se contenter de posséder l'essence du pouvoir, sans avoir l'air d'en désirer le rang et les ornements, constituait un autre art de flatter la multitude. Sa jalousie vigilante, sa vengeance longuement mûrie mais sûre, sa compétence rusée qui, pour les esprits vulgaires, tient lieu de sagesse, étaient ses seuls moyens de rivaliser avec ses éminents antagonistes.
Et il semble que ce soit une punition méritée des extravagances et des abus de la Révolution française que d'avoir engagé le pays dans un état d'anarchie qui a permis à un misérable tel que nous l'avons décrit d'être pendant une longue période maître de son destin.
Le sang était son élément, comme celui des autres terroristes, et il ne s'attachait jamais avec autant de plaisir à une nouvelle victime que lorsqu'il était en même temps un ancien associé.
Dans une épitaphe, dont le couplet suivant peut servir de traduction, sa vie était représentée comme incompatible avec l'existence de la race humaine:-
356
Le Livre des Martyrs de Foxe
"C'est ici que Robespierre dort,
Ne versez pas de larmes :
Lecteur, s'il avait vécu, vous seriez mort".
357
Le Livre des Martyrs de Foxe
Chapitre XXIV - Persécution des Protestants Français 1814-1820
Au cours des années 1814 et 1820 la persécution dans cette partie protestante de la France se poursuivit avec très peu d'interruption depuis la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV jusqu'à une très courte période précédant le début de la fin de la Révolution française.
En 1785, M. Rebaut Saint-Étienne et le célèbre M. de la Fayette furent parmi les premières personnes qui s’intéressèrent à la cour de Louis XVI en éliminant le fléau de la persécution de ce peuple blessé, les habitants du sud de France.
Telle était l'opposition des catholiques et des courtisans, et ce n’est que vers la fin de l'année 1790 que les protestants furent libérés de leurs frayeurs. Auparavant, les catholiques de Nîmes en particulier avaient pris les armes ; Nîmes présenta ensuite un spectacle effrayant
; des hommes armés couraient à travers la ville, tiraient des coins des rues et attaquaient tout ce qu'ils rencontraient avec des épées et des fourches.
Un homme appelé Astuc fut blessé et jeté dans l'aqueduc ; Baudon tomba sous les coups répétés de baïonnette et de sabres et son corps également fut jeté à l'eau ; Boucher, un jeune homme de dix-sept ans à peine, fut abattu alors qu'il regardait par la fenêtre ; trois électeurs blessés, un grièvement ; un autre électeur blessé n’échappa à la mort qu’en déclarant à plusieurs reprises qu’il était catholique ; un troisième reçut quatre blessures au sabre et fut ramené chez lui terriblement mutilé. Les citoyens qui s’enfuirent furent arrêtés par les catholiques sur les routes et obligés de donner des preuves de leur religion avant qu’ils ne leur laisser la vie sauve. M. et Mme Vogue étaient à leur maison de campagne, quand les fanatiques l’ouvrirent violemment, les massacrèrent et détruisirent leur demeure. M. Blacher, un protestant âgé de soixante-dix ans, fut coupé en morceaux avec une faucille ; le jeune Pierre, apportant de la nourriture à son frère, fut interrogé : “ Catholique ou protestant ?”
“ Protestant,” étant la réponse, un monstre tira sur le garçon et il tomba. L'un des compagnons de l'assassin dit : “ Tu aurais aussi bien tué un agneau.” “ J'ai juré,” répondit-il,
“ de tuer quatre protestants pour mon compte, et ceci compte pour un.” Cependant, comme ces atrocités amenèrent les troupes à s'unir pour la défense du peuple, une terrible vengeance fut exercée contre le parti catholique qui avait utilisé des armes, ce qui, avec d'autres circonstances, notamment la tolérance exercée par Napoléon Bonaparte, les interrompit complètement jusqu'à l'année suivante en 1814, lorsque le retour inattendu de l'ancien gouvernement les réunit de nouveau autour des anciennes bannières.
L'Arrivée du roi Louis XVIII à Paris. Cela fut connu à Nîmes le 13 Avril 1814.
En un quart d'heure, on voyait la cocarde blanche dans toutes les directions, le drapeau blanc flottait sur les édifices publics, sur les splendides monuments de l'Antiquité et même sur la tour de Magne, au-delà des murs de la ville. Les protestants, dont le commerce avait beaucoup souffert pendant la guerre, furent parmi les premiers à s'unir dans la joie générale et à envoyer leur adhésion au sénat et au corps législatif ; et plusieurs des départements 358
Le Livre des Martyrs de Foxe
protestants envoyèrent des adresses au trône, mais malheureusement, M. Froment était encore à Nîmes à ce moment-là, quand beaucoup de bigots étaient prêts à le rejoindre, l'aveuglement et la fureur du seizième siècle succédèrent rapidement à l'intelligence et à la philanthropie du dix-neuvième. Une ligne de distinction fut instantanément tracée entre des hommes de différentes opinions religieuses ; L'esprit de la vieille église catholique était de nouveau de réglementer la part d'estime et de sécurité de chacun.
La différence de religion allait maintenant gouverner tout le reste ; et même les domestiques catholiques qui avaient servi les protestants avec zèle et affection commençaient à négliger leurs devoirs, ou à les exécuter sans grâce et à contrecœur. Lors des fêtes et des spectacles donnés aux frais de l'État, l'absence des protestants leur était reprochée comme preuve de leur manque de loyauté ; et au milieu des cris de “ Vive le Roi !”, les sons discordants “ d'à bas le Maire,” à l’endroit de celui-ci, furent entendus. M. Castletan était protestant ; il apparut en public avec le préfet M. Ruland, un catholique, lorsque des pommes de terre furent jetées sur lui, et le peuple déclara qu'il devait démissionner de ses fonctions.
Les bigots de Nîmes réussirent même à obtenir une adresse à présenter au roi, affirmant qu'il ne devrait y avoir en France qu'un seul Dieu, un seul roi et une seule foi. En cela, ils furent imités par les catholiques de plusieurs villes.
L'histoire de l'enfant d'argenté à cette époque. M. Baron, conseillé à la cour royale de Nîmes, forma le plan de dédicacer à Dieu un enfant d'argent, si la duchesse d'Angoulême voulait donner un prince à la France. Ce projet fut converti en vœu religieux public, qui fit l’objet de conversations publiques et privées, tandis que des personnes, dont l’imagination était enflammée par ces débats, couraient dans les rues en criant “ Vivent les Bourbons .” ou
“ les Bourbons à jamais.” D’où cette frénésie superstitieuse, il est dit qu’à Alès, les femmes étaient conseillées et poussés à empoisonner leurs maris protestants et qu’il était enfin opportun de les accuser de crimes politiques. Ils ne pourraient plus comparaître en public sans insultes et blessures. Quand les foules rencontraient les protestants, les saisissaient et dansaient autour d'eux avec une joie barbare, au milieu des cris répétés de “ Vive le Roi,” ils chantaient des strophes disant : “ Nous nous laverons les mains avec du sang des protestants et ferons des puddings noirs du sang des enfants de Calvin.”
Les citoyens qui venaient sur les promenades pour prendre l’air et se rafraîchir dans les rues étroites et sales étaient chassés par des cris de “ Vive le Roi,” comme si ces cris devaient justifier chaque excès. Si les protestants se référaient à la Charte, ils étaient directement assurés que cela ne leur serait d'aucune utilité et qu'ils avaient seulement réussi à être détruits plus efficacement. Des personnes de rang disaient en public dans les rues : “ Tous les Huguenots doivent être tués ; cette fois, leurs enfants doivent être tués, afin qu'aucune de la race maudite ne demeure.”
Pourtant, il est vrai, ils ne furent pas assassinés, mais cruellement traités. Les enfants protestants ne pouvaient plus se mêler des sports des catholiques et n'étaient même pas 359
Le Livre des Martyrs de Foxe
autorisés à sortir sans leurs parents. À la nuit tombée, leurs familles s’enfermaient dans leurs appartements ; mais même alors, des pierres étaient lancées contre leurs fenêtres. Quand ils se levaient le matin ils n'étaient pas rares de trouver des gibets dessinés sur leurs portes ou leurs murs ; et dans les rues les catholiques tenaient des cordons déjà imbibés de savon devant leurs yeux, et désignaient les instruments par lesquels ils espéraient et avaient conçus pour les exterminer. De petites potences ou des modèles réduits étaient remis, et un homme qui vivait en face de l’un des pasteurs exposa l’un de ces modèles réduits à sa fenêtre et rendit les signes suffisamment intelligibles au passage du ministre. Un personnage représentant un prédicateur protestant était également suspendu dans un carrefour public, et les chansons les plus atroces étaient chantées sous sa fenêtre.
Vers la fin du carnaval, un plan avait même été formé pour caricaturer les quatre ministres de l'endroit et pour brûler leur effigie ; mais cela fût empêché par le maire de Nîmes, un protestant. Une chanson terrible présenté au préfet, dans le dialecte du pays, avec une fausse traduction, fut imprimée avec son approbation, et eut une belle durée de vie avant qu’il ne se rende compte de l'ampleur de l’erreur dans laquelle on l’avait induit. Le soixante-troisième régiment de ligne fut censuré et insulté publiquement pour avoir, conformément à l'ordre public, protégé les protestants. En fait, les protestants semblaient être comme des moutons destinés au massacre.
Les armes catholiques à Beaucaire en mai 1815, une association fédérative, semblable à celle de Lyon, Grenoble, Paris, Avignon et Montpellier, était recherchée par de nombreuses personnes à Nîmes ; mais cette fédération s'est terminée ici après une existence éphémère et illusoire de quatorze jours. Entre temps, un groupe important de fanatiques catholiques était en armes à Beaucaire, et ceux-ci poussèrent bientôt leur patrouille si près des murs de Nîmes,
“ de manière à alarmer les habitants.” Ces catholiques se tournèrent vers les anglais de Marseille pour obtenir de l'aide et obtinrent la concession de mille mousquets, dix mille cartouches, etc.
Le général Gilly fut cependant bientôt envoyé contre ces partisans, qui les empêchèrent de commettre le pire en leur accordant un armistice ; et pourtant, quand Louis XVIII était rentré à Paris, après l'expiration du règne de Napoléon pendant cent jours, la paix et l'esprit de parti semblaient avoir été soumis, même à Nîmes, des groupes de Beaucaire rejoignirent Trestaillon dans cette ville pour vider la vengeance qu’ils avaient si longtemps prémédité. Le Général Gilly avait quitté le département plusieurs jours : les troupes de ligne laissées avaient pris la cocarde blanche et attendaient d'autres ordres, tandis que les nouveaux commissaires n'avaient qu'à proclamer la cessation des hostilités et l'établissement complet de l'autorité du roi. En vain, aucun commissaire n'apparut, aucune dépêche n'arriva pour calmer et réguler l'esprit du public ; mais vers le soir l'avant-garde des bandits, à hauteur de plusieurs centaines, entra dans la ville, non désirés mais sans opposition.
360
Le Livre des Martyrs de Foxe
Comme ils marchaient sans ordre ni discipline, couverts de vêtements ou de guenilles de toutes les couleurs, décorés de cocardes, non pas blanches mais blanches et vertes, armés de mousquets, de sabres, de fourches, de pistolets et de crochets destinés à la récolte, enivrés de vin et teintés du sang des protestants qu’ils avaient assassinés sur leur route, ils présentaient un spectacle affreux et vil à voir. Sur la place devant la caserne, ce bandit fut rejoint par la foule armée de la ville, dirigée par Jacques Dupont, dit Trestaillon.
Pour éviter l’effusion de sang, cette garnison d'environ cinq cents hommes consentit à capituler et sortit triste et sans défense ; mais quand environ cinquante furent passés, la populace commença à faire un grand feu sur leurs victimes confiantes et non protégées ; presque tous furent tués ou blessés, et très peu d'entre eux purent rentrer avant que les portes de la garnison ne soient à nouveau fermées. Celles-ci furent à nouveau forcées en un instant et tous ceux qui n’avaient pas pu grimper sur les toits ou sauter dans les jardins adjacents furent massacrés. En un mot, la mort les rencontra partout et sous toutes les formes, et ce massacre catholique rivalisa de cruauté et dépassa dans la traîtrise les crimes des assassins de septembre à Paris et des boucheries jacobines de Lyon et d'Avignon. Il fut marqué non seulement par la ferveur de la Révolution, mais par la subtilité de la ligue et restera longtemps une tache dans l'histoire de la seconde restauration.
Massacre et pillage à Nîmes. Nîmes présentait à présent une scène affreuse d’indignation et de carnage, bien que de nombreux protestants s’étaient enfuis aux Convènes et à la Gardonnenque. Les maisons de campagne de Messieurs Rey, Guiret et plusieurs autres furent pillées et les habitants traités avec une barbarie gratuite. Deux partis avaient comblé leurs appétits sauvages sur la ferme de Mme Frat : le premier, après avoir mangé, bu, puis brisé les meubles et volé ce qui lui paraissait convenable, avait pris congé en annonçant l'arrivée de leurs camarades, “ par rapport à qui,” ils dirent, “ ils devraient être considérés comme étant miséricordieux.” Trois hommes et une vieille femme furent laissés sur les lieux : à la vue de la deuxième compagnie, deux des hommes s’enfuirent. “ Es-tu catholique ?” dit le bandit à la vieille femme. “ Oui.” “ Répètes, alors, ton Pater et Ave.”
Terrifiée, elle hésita et fut immédiatement renversée avec un mousquet. En reprenant ses esprits, elle s’échappa de la maison mais rencontra Ladet, le vieux valet de ferme, apportant une salade que les déprédateurs lui avaient ordonnée de couper. En vain, elle essaya de le persuader de fuir. “ Es-tu protestant ?” Se sont-ils écriés ; “ Je le suis.” Un mousquet fut lancé sur lui, il tomba blessé, mais pas mort. Pour consommer leur travail, les monstres allumèrent un feu avec de la paille et des planches, jetèrent leur victime vivante dans les flammes et la laissèrent expirer dans les plus terribles agonies. Ils mangèrent ensuite leur salade, omelette, etc. Le lendemain, des ouvriers, voyant la maison ouverte et déserte, entrèrent et découvrirent le corps à moitié consumé de Ladet. Le préfet du Gard, M. Darbaud Jouques, essayant de pallier les crimes des catholiques, eut l'audace d'affirmer que Ladet avait été catholique ; mais cela fut publiquement contredit par deux des pasteurs de Nîmes.
361
Le Livre des Martyrs de Foxe
Un autre parti commis un terrible meurtre à Saint-Césaire, sur Imbert la Plume, le mari de Suzon Chivas. Il fit une rencontre à son retour du travail dans les champs. Le chef lui promis la vie sauve, mais insista pour qu'il soit conduit à la prison de Nîmes. Voyant cependant que le parti était déterminé à le tuer, il reprit son caractère naturel et, étant un homme puissant et courageux, il s'avança et s'écria : “ Vous êtes des brigands, tirez !” Quatre d'entre eux tirèrent et il tomba, mais il n'était pas mort ; et alors qu’il était encore vivant ils mutilèrent son corps
; et puis après avoir passé une corde autour de lui, le traînèrent, attaché à un canon qu’ils possédaient. Ce n'est qu'après huit jours que ses proches furent informés de sa mort. Cinq personnes de la famille de Chivas, tous maris et pères, furent massacrés en quelques jours.
Le traitement impitoyable des femmes dans cette persécution à Nîmes aurait déshonoré tous les sauvages dont on n’a jamais entendu parler. Les veuves Rivet et Bernard furent obligées de sacrifier des sommes énormes ; et la maison de Mme Lecointe fut ravagée et ses biens détruits. Mme F. Didier vit sa maison saccagée et presque démolie jusqu’à la fondation.
Un parti de ces bigots rendit visite à la veuve Perrin, qui vivait dans une petite ferme près des moulins à vent ; ayant commis toutes sortes de dévastations, ils attaquèrent même le sanctuaire des morts, qui contenait les reliques de sa famille. Ils sortirent les cercueils et dispersèrent le contenu sur les terrains adjacents. C’est en vain que cette veuve outragée ramassa les os de ses ancêtres et les replaça : ils furent à nouveau déterrés ; et, après plusieurs efforts inutiles, ils furent laissés à contrecœur, éparpillés à la surface des champs. Enfin, le décret royal en faveur des persécutés, le décret de Louis XVIII annulant tous les pouvoirs extraordinaires conférés soit par le roi, soit par les princes, soit par des agents subordonnés, fut reçu à Nîmes
, et les lois devaient maintenant être administrées par les organes ordinaires et un nouveau préfet arriva pour les mener à bien ; mais malgré les proclamations, le travail de destruction, arrêté pour un moment, ne fut pas abandonné, mais bientôt repris avec vigueur et effet. Le 30
juillet, Jacques Combe, père de famille, fut tué par des gardes nationaux de Rusau. Le crime était si public que le commandant du parti rendit à la famille le portefeuille et les papiers du défunt. Le lendemain, une foule tumultueuse parcourait la ville et les banlieues, menaçant les paysans misérables ; et le premier août, elle les massacra sans opposition.
Le même jour, vers midi, six hommes armés, dirigés par Truphémy, le boucher, encerclèrent la maison de Monot, un charpentier ; deux membres du groupe, des forgerons, étaient au travail à la maison la veille et avaient vu un protestant qui s'y était réfugié, M.
Bourillon, qui avait été lieutenant dans l'armée et qui avait une pension de retraite. C'était un homme d'un excellent caractère, pacifique et inoffensif, qui n'avait jamais servi l'empereur Napoléon. Truphémy ne le connaissant pas, il fut identifié alors qu’il était en train de prendre un petit-déjeuner frugal avec sa famille. Truphémy lui ordonna de l'accompagner, ajoutant :
“ Ton ami Saussine est déjà dans l'autre monde.” Truphémy le plaça au milieu de sa troupe et lui ordonna astucieusement de crier “ Vive l'Empereur,” ce qu'il refusa, ajoutant qu'il n'avait jamais servi l'Empereur. C’est en vain que les femmes et les enfants de la maison intercédèrent pour qu’il ait la vie sauve et louèrent ses qualités aimables et vertueuses. Il fut conduit sur 362
Le Livre des Martyrs de Foxe
l'esplanade et abattu, d'abord par Truphémy puis par les autres. Plusieurs personnes, attirées par les coups de feu, s’approchèrent mais furent menacées de subir le même sort.
Après un certain temps, les misérables s'en allèrent en criant “ Vive le Roi !”. Certaines femmes les rencontrèrent et l'une d'entre elles, apparemment touchée, déclara : “ Pour mon compte, j'ai tué sept personnes aujourd'hui, et si vous dites un mot, vous serez la huitième.”
Pierre Courbet, un tisserand de bas, fut séparé de son métier à tisser par un groupe armé et fut abattu devant sa propre porte. Sa fille aînée fut renversée avec la crosse d'un mousquet ; et un poignard fut mis à la poitrine de sa femme pendant que la foule pillait ses appartements. Paul Héraut, un tisserand de soie, fut littéralement coupé en morceaux en présence d'une foule nombreuse et au milieu des cris et des larmes inutiles de sa femme et de ses quatre jeunes enfants. Les meurtriers n’abandonnèrent le cadavre que pour retourner chez Héraut et s’emparer de tout ce qui avait de la valeur. Le nombre de meurtres commis ce jour-là ne put pas être déterminé. Une personne vit six corps à Cour Neuf alors que neuf autres étaient transportés à l'hôpital.
Si le meurtre quelques temps après devint moins fréquent pendant quelques jours, le pillage et les contributions forcées furent appliquées activement. M. Salle d'Hombro, à plusieurs reprises, fut dépouillé de sept mille francs ; et à une occasion, quand il plaida pour les sacrifices qu'il avait faits. “ Regarde,” dit un bandit en montrant sa pipe, “ Ceci mettra le feu à ta maison et cela .” brandissant son épée “ mettra fin à ta vie.” Aucune réponse ne put être donnée à ces arguments. On déroba à M. Féline, un fabricant de soie, trente-deux mille francs d'or, trois mille francs d'argent et plusieurs balles de soie.
Les petits commerçants étaient continuellement exposés à des visites et à des demandes de provisions, de draperies ou de tout ce qu'ils vendaient ; et aux mêmes mains qui avaient mis le feu aux maisons des riches et dévasté, brisé les métiers du tisserand ; et volé les outils de l'artisan. La désolation régna dans le sanctuaire et dans la ville. Les bandes armées, au lieu d'être réduites furent augmentées ; les fugitifs, au lieu de revenir, recevaient des adhésions constantes, et leurs amis qui les hébergeaient étaient réputés rebelles. Les protestants qui restèrent furent privés de tous leurs droits civils et religieux, et même les avocats ainsi que les huissiers signèrent une résolution visant à exclure de leur corps toute “ la prétendue religion réformée.” Ceux qui travaillaient dans la vente de tabac furent privés de leurs licences. Les diacres protestants qui avaient la charge des pauvres étaient tous dispersés. Sur cinq pasteurs, il n'en restait que deux ; l'un d'entre eux fut obligé de changer de résidence et ne pouvait s'aventurer qu’à administrer les consolations de la religion ou exercer les fonctions de son ministère sous le couvert de la nuit.
Non contents de ces tourments, des publications calomnieuses et incendiaires accusaient les protestants d'élever le blason proscrit dans les communes et d'invoquer Napoléon déchu ; et, bien sûr, comme indigne la protection des lois et la faveur du monarque.
363
Le Livre des Martyrs de Foxe
Des centaines de personnes après cela furent traînées en prison sans même un ordre écrit
; et bien qu'un journal officiel portant le titre de Journal du Gard fût créé pendant cinq mois, alors qu'il était influencé par le préfet, le maire et d'autres fonctionnaires, le mot “ charte .”
n'y fut jamais utilisé une seule fois. Un des premiers chiffres, au contraire, représentait les protestants souffrants, comme des “ Crocodiles, pleurant seulement de rage et de regret de ne plus avoir de victimes à dévorer ; comme des personnes ayant dépassé Danton, Marat et Robespierre dans l’art du mal ; et comme ayant prostitué leurs filles à la garnison pour la faire gagner à Napoléon.” Un extrait de cet article, estampillé de la couronne et des armoiries des Bourbons, fut colporté dans les rues et le vendeur fut décoré de la médaille de la police.
Pétition des réfugiés protestants. A ces reproches, il convient d'opposer la pétition que les réfugiés protestants de Paris avaient présentée à Louis XVIII au nom de leurs frères à Nîmes.
“ Nous déposons à vos pieds, Sire, nos souffrances aiguës. En votre nom, nos concitoyens sont massacrés et leurs biens dévastés. Des paysans égarés, dans une prétendue obéissance à vos ordres, se sont rassemblés sous le commandement d'un Commissaire nommé par votre auguste neveu. Bien que prêts à nous attaquer, ils ont été reçus avec l'assurance de la paix. Le 15 juillet 1815, nous avons appris l'entrée de Votre Majesté à Paris, et le drapeau blanc a immédiatement été brandi à nos édifices. La tranquillité publique n'a pas été troublée. La garnison a capitulé mais assaillie au moment du départ des troupes et celles-ci presque totalement massacrée. Notre garde nationale a été désarmée, la ville remplie d’étrangers et les maisons des principaux habitants professant la religion réformée ont été attaquées et pillées.
Nous joignons la liste. La terreur a chassé de notre ville les habitants les plus respectables.”
“ Votre Majesté a été trompée si on n’a pas présenté devant elle le tableau des horreurs qui font votre bonne ville de Nîmes un désert. Des arrestations et des interdits se produisent continuellement, et la différence entre des opinions religieuses est la seule et réelle cause. Les protestants calomniés sont les défenseurs du trône. Votre neveu a vu nos enfants sous ses bannières, notre fortune a été placée entre ses mains. Attaqués sans raison, les Protestants n'ont pas, même par une juste résistance, donné à leur ennemi le fatal prétexte pour la calomnie. Sauvez-nous, Sire ! Eteignez la marque de la guerre civile! Un seul acte de votre volonté rétablirait l'existence politique d'une ville intéressante quant à sa population et ses manufactures. Demandez des comptes pour leur conduite aux chefs qui ont apporté ces malheurs sur nous. Nous mettons sous vos yeux tous les documents qui nous sont parvenus.
La peur paralyse les cœurs et étouffe les plaintes de nos concitoyens. Nous trouvant dans un lieu plus sûr nous nous risquons à faire entendre notre voix en leur nom,” etc., etc.
Scandale monstrueux sur les femmes à Nîmes, on sait que les femmes lavent leurs vêtements soit aux fontaines, soit au bord des ruisseaux. Il y a un grand bassin près de la fontaine, où l'on peut voir chaque jour un nombre de femmes agenouillé au bord de l'eau et frappant les vêtements avec de gros morceaux de bois en forme de raquettes. Cet endroit est devenu le théâtre des pratiques les plus honteuses et les plus indécentes. La populace 364
Le Livre des Martyrs de Foxe
catholique a retourné les jupons des femmes et les ont alors attachés afin qu’elles continuent à être exposées et à être soumises à une espèce de châtiment nouvellement inventé ; avec des clous placés dans le bois des battoirs sous forme de fleur de lis, ils les frappaient jusqu'à ce que le sang leur coulait à flots et que leurs cris retentissent. La mort était souvent demandée en échange de cette punition ignoble, mais refusée avec une joie maligne. Afin de porter leur outrage au plus haut degré possible, plusieurs femmes en état de grossesse ont été agressées de cette manière. La nature scandaleuse de ces atteintes a empêché de nombreuses victimes de les rendre publiques et, surtout, de faire état des circonstances les plus aggravantes. “ Je l'ai vu,” dit M. Duran, “ un avocat catholique, accompagnant les assassins du faubourg Bourgade, “ armer un battoir de clous pointus en forme de fleur de lys ; je les ai vus soulever les vêtements de femmes et appliquer, à coups lourds, au corps ensanglanté de ce battoir ou raquette, auquel ils ont donné un nom que ma plume refuse d'écrire. Les cris des victimes (les flots de sang) les murmures d'indignation supprimés par la peur, rien ne pouvait les émouvoir.
Les chirurgiens qui ont examiné ces femmes mortes peuvent attester, par les marques de leurs blessures, les agonies qu’elles ont dû subir, qui, pour horrible qu’elle soit, sont tout à fait vraies.”
Néanmoins, au cours de ces horreurs et de ces obscénités, si honteuses pour la France et la religion catholique, les agents du gouvernement disposaient d'une force puissante qui, en les employant honnêtement, aurait pu rétablir la tranquillité. Cependant, les magistrats catholiques firent un clin d'œil au meurtre et au vol, et à de très rares exceptions près ; les autorités administratives, il est vrai, utilisèrent des mots dans leurs proclamations, etc., mais n'eurent jamais recours à des actions pour mettre fin aux énormités des persécuteurs, qui déclarèrent hardiment que le 24, anniversaire de Saint-Barthélemy, ils avaient l’intention de perpétrer un massacre général. Les membres de l'Église Réformée étaient remplis de terreur et, au lieu de prendre part à l'élection des députés, ils étaient occupés à faire de leur mieux pour assurer leur sécurité personnelle.
Outrages Commis dans les Villages, etc.
Nous quittons maintenant Nîmes pour examiner la conduite des persécuteurs dans le pays environnant. Après le rétablissement du gouvernement royal, les autorités locales se distinguèrent par leur zèle et leur détermination à soutenir leurs employeurs et, sous prétexte de rébellion, de dissimulation d’armes, de non-paiement de contributions, etc., des troupes, des gardes nationaux et des foules armées furent autorisées à piller, arrêter et assassiner des citoyens paisibles, non seulement en toute impunité, mais avec encouragement et approbation.
Dans le village de Milhaud, près de Nîmes, les habitants furent souvent contraints de payer des sommes importantes pour éviter d’être pillés. Madame Teulon n'aurait eu cependant aucun intérêt à cela : le dimanche 16 juillet, sa maison et son terrain furent ravagés ; les précieux meubles enlevés ou détruits, le foin et le bois brûlés, et le cadavre d'un enfant enterré dans le jardin, emporté et traîné autour d'un feu fait par la foule. C'est avec beaucoup de difficulté que M. Teulon s'échappa vivante.
365
Le Livre des Martyrs de Foxe
M. Picherol, un autre protestant, avait déposé une partie de ses effets chez un voisin catholique ; cette maison fut attaquée et, bien que tous les biens de ce dernier furent respectés, ceux de son ami furent saisis et détruits. Dans le même village, un membre d'un parti doutant que M. Hermet, un tailleur, soit l'homme qu'ils recherchaient, demanda : “ Est-il protestant ?”
ce qu’il reconnut. “ Bien,” dirent-ils, et il fut assassiné sur le coup. Dans le canton de Vauvert, où se trouvait une église de consistoire, quatre-vingt mille francs furent extorqués.
Dans les communes de Beauvoisin et de Générac, des excès similaires furent commis par une poignée d'hommes licencieux, sous l'œil du maire catholique et aux cris de “ Vive le Roi
!” St. Gilles fut la scène de la pire des infamies. Les protestants, les plus fortunés parmi les habitants, furent désarmés tandis que leurs maisons étaient pillées. Un appel fut fait au maire, mais il rit et s'éloigna. Cet officier avait à sa disposition une garde nationale de plusieurs centaines d'hommes, organisée par ses propres ordres. Il serait fastidieux de lire la liste des crimes qui se produisirent pendant plusieurs mois. À Calvisson, le maire interdit aux protestants de chanter les psaumes communément utilisés dans le temple pour empêcher les catholiques d'être offensés ou dérangés. À Sommières, à une quinzaine de kilomètres de Nîmes, les catholiques firent une magnifique procession dans la ville, qui se poursuivit jusqu'au soir, à laquelle succéda le pillage des protestants. À l'arrivée des troupes étrangères à Sommières, la prétendue recherche d'armes fut reprise ; ceux qui ne possédaient pas de mousquets étaient même obligés de les acheter exprès pour les rendre, et les soldats y étaient cantonnés à six francs par jour jusqu'à ce qu'ils produisent les articles demandés. L'église protestante qui avait été fermée fut transformée en caserne pour les Autrichiens.
Après que le service divin ait été suspendu pendant six mois à Nîmes, l'église, appelée le temple par les protestants, fut rouverte et un culte public fut célébré dans la matinée du 24
décembre. En examinant le clocher, il fut découvert que certaines personnes avaient emporté le clapet de la cloche. À l'approche de l'heure du service, un certain nombre d'hommes, de femmes et d'enfants se rassemblèrent à la maison de M. Ribot, le pasteur, et menacèrent d'empêcher le culte. A l'heure convenue, lorsqu'il se dirigea vers l'église, il fut encerclé ; les cris les plus sauvages s’élevèrent contre lui ; certaines femmes le saisirent par le col ; mais rien ne pouvait troubler sa fermeté ou exciter son impatience ; il entra dans la maison de prière et monta à la chaire. Des pierres furent lancées et tombèrent au milieu des fidèles ; la congrégation resta néanmoins calme et attentive et le service se termina au milieu du bruit, des menaces et de l'indignation.
En se retirant, beaucoup auraient été tués sans les chasseurs de la garnison, qui les protégèrent honorablement avec zèle. M. Ribot, capitaine de ces chasseurs, reçut peu après la lettre suivante:
2 janvier 1816.
“ Je regrette profondément les préjugés des catholiques contre les protestants, qui prétendent qu'ils n'aiment pas le roi. Continuez à agir comme vous l'avez fait jusqu'ici, et votre 366
Le Livre des Martyrs de Foxe
temps et votre conduite convaincront les catholiques du contraire : si un tumulte semblable à celui de samedi dernier se répète, informez-moi. Je conserve mes rapports sur ces actes et si les agitateurs se révèlent incorrigibles et oublient ce qu’ils doivent au meilleur des rois et à la Charte, je ferai mon devoir et informerai le gouvernement de leurs actes. Adieu, mon cher monsieur, assurez le consistoire de mon estime et du sens que j’entends de la modération avec laquelle ils ont répondu aux provocations des malfaisants de Sommières, j’ai l’honneur de vous saluer avec respect.
SUVAL DE LAINE.”
Une autre lettre du marquis de Montlaur à ce digne pasteur fut reçue le 6 janvier pour l’encourager à s’unir à tous les hommes de valeur qui croient en Dieu afin d’obtenir le châtiment des assassins, des brigands et des perturbateurs de la tranquillité publique, et de lire publiquement les instructions qu'il avait reçues du Gouvernement à cet effet. Malgré cela, le 20 janvier 1816, lors de la célébration du service commémoratif de la mort de Louis XVI, une procession se forma. Les gardes nationaux tirèrent sur le drapeau blanc suspendu aux fenêtres des protestants et clôturèrent la journée en pillant leurs maisons.
Dans la commune d’Anguargues, la situation était encore pire ; et dans celle de Fontanes, dès l'entrée du roi en 1815, les catholiques rompirent tous les termes avec les protestants ; le jour, ils les insultaient et, la nuit, ouvraient leurs portes ou les marquaient avec de la craie pour qu'ils soient pillés ou brûlés. St. Mamert fut visité à plusieurs reprises par ces vols ; et à Montmiral, jusqu'au seize juin 1816, les protestants furent attaqués, battus et emprisonnés pour avoir osé célébrer le retour d'un roi qui avait juré de préserver la liberté religieuse et de maintenir la Charte.
Autres récits des actes des catholiques à Nîmes. Il semble que les excès perpétrés dans le pays n’aient nullement détourné l’attention des persécuteurs de Nîmes. Octobre 1815
commença sans aucune amélioration des principes ou des mesures du Gouvernement, ce qui fut suivi d'une présomption correspondante de la part du peuple. Plusieurs maisons du quartier Saint-Charles furent pillées et leurs épaves brûlées dans les rues au milieu de chants, de danses et de cris de “ Vive le Roi !”. Le maire s’y rendit, mais la joyeuse multitude feignit de ne pas le connaître et, lorsqu'il se risqua à faire des reproches, ils lui dirent que : “ Sa présence était inutile et qu’il pouvait se retirer.” Au cours de la journée du seize octobre, chaque préparatif semblait annoncer une nuit de carnage ; les ordres de rassemblement et les signaux d’attaque circulaient avec régularité et confiance ; Trestaillon passa en revue ses troupes et les incita à perpétrer des crimes, en tenant avec l'un de ces misérables le dialogue suivant: Membre de la troupe. “ Si tous les protestants, sans exception, doivent être tués, je m'engagerai avec joie ; mais comme vous m'avez si souvent trompé, à moins qu'ils ne soient tous prêts à partir, je ne vais pas m'émouvoir.”
Trestaillon. “ Viens donc, cette fois, pas un seul homme ne s'échappera.”
367
Le Livre des Martyrs de Foxe
Ce but horrible aurait été exécuté n’eût été le Général La Garde, commandant du département. Ce n'est que vers dix heures du soir qu'il s'aperçut du danger ; il sentait maintenant que pas un instant ne devait être perdu. Les foules avançaient à travers les banlieues et les rues se remplissaient de ruffians, scandant les plus horribles imprécations. Le Général sonna à onze heures et ajouta à la confusion qui se propageait maintenant dans la ville. Quelques troupes se rallièrent au comte La Garde, qui était plein de détresse à la vue du mal qui était arrivé à un tel point. M. Durand, avocat catholique, donna le récit suivant:
“ Il était près de minuit, ma femme venait de s'endormir ; j'écrivais à ses côtés, quand nous avons été dérangés par un bruit lointain ; des tambours semblaient traverser la ville dans tous les sens. Qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire ? Pour la calmer, je lui dis que cela annonçait probablement l'arrivée ou le départ de certaines troupes de la garnison, mais les coups de feu et les cris ont été immédiatement audibles et, en ouvrant ma fenêtre, j'ai distingué d'horribles imprécations mêlées aux cris de “ Vive le Roi !” J'ai réveillé un officier logé dans la maison, et M. Chancel, Directeur des Travaux Publics. Nous sommes sortis ensemble et avons gagné le Boulevard. La lune brillait et presque chaque objet était presque aussi distinct que le jour ; une foule furieuse pressait l'extermination, et la plus grande partie à moitié nue, armée de couteaux, de mousquets, de bâtons et de sabres.
En réponse à mes questions, on m'a dit que le massacre était général et que beaucoup avaient déjà été tués dans les banlieues. M. Chancel se retira pour revêtir son uniforme de capitaine des Pompiers ; les officiers se retirèrent à la caserne et anxieux pour ma femme, je suis rentré chez moi. Au bruit, j'étais convaincu que des personnes suivaient. Je me glissais dans l'ombre du mur, ouvrais ma porte, entrais et la fermais, laissant une petite ouverture par laquelle je pouvais observer les mouvements du groupe dont les bras brillaient au clair de lune. Quelques instants après, des hommes armés sont apparus conduisant un prisonnier à l'endroit même où j'étais dissimulé. Ils se sont arrêtés, j'ai fermé ma porte doucement et monté sur un aulne planté contre le mur du jardin.
Quelle scène! Un homme à genoux implorant la miséricorde des misérables qui se moquaient de son agonie et le chargeaient d'abus. “Au nom de ma femme et de mes enfants, dit-il, épargnez-moi! Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi m'assassineriez-vous pour rien ? J'étais sur le point de crier et de menacer les meurtriers avec un sentiment de vengeance. Il ne me fallut pas longtemps pour délibérer, la décharge de plusieurs fusils mit fin à mon suspense ; le malheureux suppliant, frappé aux reins et à la tête, tomba pour ne plus se relever. Les dos des assassins étaient vers l'arbre ; ils se retirèrent immédiatement, rechargeant leurs pièces. Je suis descendu et j'ai approché le mourant qui poussait des gémissements profonds et mornes.
Des gardes nationaux sont arrivés sur le moment et je me suis de nouveau retiré et j'ai fermé la porte. “Je vois, dit l'un d'eux, un homme mort.
“ Il gémit encore, dit un autre. “Ce sera mieux, dit un troisième de l'achever et le sortir de sa misère. Cinq ou six mousquets ont été tirés instantanément et les gémissements ont cessé.
368
Le Livre des Martyrs de Foxe
Le lendemain, des foules sont venues inspecter et insulter le défunt. Un jour après le massacre, on observait toujours une sorte de fête et chaque occupation était laissée pour aller regarder les victimes.” C'était Louis Lichare, père de quatre enfants ; et quatre ans après l'événement, M. Durand confirma ce récit par son serment lors du procès de l'un des meurtriers.
Attaque contre les églises protestantes. Quelque temps avant la mort du Général La Garde, le duc d'Angoulême s'était rendu à Nîmes et dans d'autres villes du sud, et à l’ancienne place, il honora les membres du consistoire protestant en leur promettant protection et en les encourageant à rouvrir leur temple si longtemps fermés. Ils avaient deux églises à Nîmes, et il était convenu que la petite devrait être préférée à cette occasion et que sonner de la cloche devrait être supprimé. Le Général La Garde déclara qu'il donnerait sa tête pour la sécurité de sa congrégation. Les protestants s’informèrent en privé que le culte devait à nouveau être célébré à 10 heures et ils commencèrent à se réunir silencieusement et prudemment. Il fut convenu que M. Juillerat Chasseur effectuerait le service, bien que sa conviction du danger soit telle qu'il implora sa femme, ainsi qu'une partie de son troupeau de rester avec leurs familles.
Le temple n'étant ouvert que pour des raisons de forme et conformément aux ordres du duc d'Angoulême, ce pasteur voulait être la seule victime. Sur son chemin, il rencontra de nombreux groupes qui le considéraient avec des regards féroces. “ C'est le moment,” disait certains, “ de leur donner le coup de grâce.” “ Oui,” ajoutèrent les autres, “ et ni les femmes ni les enfants ne doivent être épargnés.” Un misérable, élevant la voix au-dessus des autres, s'exclama : “ Ah, je vais aller chercher mon mousquet, et dix pour mon compte.” Par ces sons inquiétants, M. Juillerat poursuivit sa course, mais lorsqu'il gagna le temple, le sacristain n'eut pas le courage d'ouvrir la porte et fut obligé de le faire lui-même.
Lorsque les fidèles arrivèrent, ils trouvèrent des personnes étranges qui avaient pris possession des rues adjacentes et, sur des marches de l'église, jurant que leur culte ne devrait pas avoir lieu. Et criant : “ À bas les protestants! Tuez- les! Tuez-les!” À dix heures, l'église étant presque remplie, M. Juillerat Chasseur commença les prières ; le calme qui suivit fut de courte durée. Soudain, le ministre fut interrompu par un bruit violent et plusieurs personnes entrèrent, vociférant les cris les plus terribles qui se mêlaient à “ Vive le Roi !”, mais les gendarmes réussirent à faire sortir ces fanatiques et à fermer les portes. Le bruit et le tumulte au dehors dès lors redoubla, et les coups de la populace essayant de forcer les portes firent résonner la bâtisse de cris et de gémissements. La voix des pasteurs qui essayaient de consoler leur troupeau était inaudible : ils essayaient en vain de chanter le Psaume quarante-deux.
Trois quarts d'heure s'écoulèrent lourdement. “ Je me suis placée,” dit Mme Juillerat, “ au bas de la chaire, avec ma fille dans les bras ; mon mari m'a enfin rejoint et soutenue ; je me rappelle que c'était notre anniversaire de mon mariage. Après six ans de bonheur. J'ai dit : Je vais mourir avec mon mari et ma fille, nous serons assassinés à l'autel de notre Dieu, victimes 369
Le Livre des Martyrs de Foxe
d'un devoir sacré, et le ciel s'ouvrira pour nous recevoir, ainsi que nos malheureux frères. J'ai béni le Rédempteur et, sans maudire nos meurtriers, j’attendais leur approche.”
M. Olivier, fils de pasteur, officier des troupes royales de front, essaya de quitter l'église, mais les sentinelles amicales à la porte lui conseillèrent de continuer à subir le siège avec les autres. Les gardes nationaux refusèrent d'agir et la foule fanatique profita de l'absence du Général La Garde et de son nombre croissant. Enfin, le son de la musique martiale se fit entendre et des voix de l’extérieur appelèrent les assiégés “Ouvrez, ouvrez et sauvez-vous!”
Leur première impression fut une peur de la traîtrise, mais ils furent bientôt assurés qu'un détachement revenant de la messe était dressé devant l'église pour favoriser la retraite des protestants. La porte fut ouverte et beaucoup d'entre eux s'échappèrent parmi les rangs des soldats qui avaient conduit la foule devant eux, mais cette rue, ainsi que d'autres par lesquelles les fugitifs devaient passer, fut bientôt remplie de nouveau.
Le vénérable pasteur Olivier Desmond, âgé de soixante-dix à quatre-vingt ans fut entouré d'assassins ; ils lui mirent les poings au visage et s’écrièrent : “ Tuez le chef des brigands.” Il fut préservé grâce à la fermeté de quelques officiers parmi lesquels se trouvait son propre fils
; ils firent autour de lui un rempart avec leurs corps et au milieu de leurs sabres nus le conduisirent chez lui. M. Juillerat, qui avait assisté au service divin avec son épouse à ses côtés et son enfant dans ses bras, fut poursuivi et assailli de pierres, sa mère reçut un coup sur la tête et sa vie fut en danger quelque temps. Une femme fut honteusement fouettée et plusieurs autres blessées et traînées dans les rues ; le nombre de protestants plus ou moins maltraités à cette occasion se situait entre soixante-dix et quatre-vingts.
Assassinat du général La Garde. Enfin, le récit de l'assassinat du comte La Garde, qui, recevant un récit de ce tumulte, monta à son cheval et entra dans une des rues, fit échec à ces excès, pour disperser la foule. Un méchant saisit sa bride ; un autre présenta le museau d'un pistolet près de son corps et s'écria : “ Misérable, tu me fais me retirer!” Il tira immédiatement.
Le meurtrier était Louis Boissin, un sergent de la garde nationale ; mais, bien que tout le monde le sache, personne ne chercha à l'arrêter et il réussit à s'échapper. Dès que le général se trouva blessé, il donna l'ordre à la gendarmerie de protéger les protestants et partit au galop vers son hôtel ; mais s'est évanoui immédiatement à son arrivée. En se remettant, il empêcha au chirurgien de fouiller sa blessure avant d’avoir écrit une lettre au Gouvernement, lui indiquant qu’en cas de décès, on pourrait savoir de quel côté était le coup porté et que personne ne pouvait oser accuser les protestants de ce crime.
La mort probable de ce Général provoqua un léger relâchement de la part de ses ennemis et un certain calme ; mais la masse du peuple avait été trop longtemps en libertinage pour pouvoir être restreinte même par le meurtre du représentant de son roi. Le soir, ils se rendirent de nouveau au temple.et avec des haches et cassèrent la porte ; le bruit lugubre de leurs coups sema la terreur dans le sein des familles protestantes assises dans leurs maisons en larmes. Le contenu de la boîte d’aumônes aux pauvres et les vêtements préparés pour la distribution 370
Le Livre des Martyrs de Foxe
furent volés ; les robes du ministre mis en pièces ; les livres déchirés ou emportés ; les placards saccagés, mais les pièces contenant les archives de l'église et les synodes furent sécurisées de façon providentielle ; et s'il n'y avait pas eu les nombreuses patrouilles à pied, l'ensemble serait devenu la proie des flammes, et l'édifice lui-même serait un tas de ruines. En attendant, les fanatiques attribuèrent ouvertement le meurtre du Général à sa propre dévotion et dirent :
“ c'est comme la volonté de Dieu.” Trois mille francs furent offerts pour l'arrestation de Boissin ; mais il était bien connu que les protestants n'osaient pas l'arrêter et que les fanatiques ne le feraient pas. Au cours de ces événements, le système des conversions forcées au catholicisme progressait de manière régulière et effrayante.
Intervention du Gouvernement britannique. Au crédit de l'Angleterre, le compte rendu de ces persécutions cruelles exercées contre nos frères protestants en France donna au Gouvernement le sentiment qu'il était déterminé à se mêler de la situation ; et maintenant les persécuteurs des protestants firent de cet acte spontané d'humanité et de religion le prétexte pour accuser les victimes d'une correspondance de trahison avec l'Angleterre ; mais au milieu de leurs manigances, à leur grande consternation, une lettre parut, envoyée quelque temps auparavant à l’Angleterre par le duc de Wellington, déclarant qu’” il existait de nombreuses informations sur les événements du sud.”
Les ministres des trois confessions à Londres, soucieux de ne pas être induits en erreur, demandèrent à l'un de leurs frères de se rendre sur les lieux de la persécution et d'examiner avec impartialité la nature et l'étendue des maux qu'ils souhaitaient soulager. Le révérend Clément Pérot entreprit cette tâche difficile et exauça leurs souhaits avec zèle, prudence et dévouement, avant tout éloge. Son retour fournit une preuve abondante et incontestable d'une persécution honteuse, des documents pour un appel devant le Parlement britannique et un rapport imprimé qui circula sur le continent et qui, pour la première fois, transmit des informations correctes aux habitants de la France.
L'interférence étrangère était maintenant jugée extrêmement utile ; et les déclarations de tolérance qu’elle suscita du Gouvernement français, ainsi que la marche plus prudente des persécuteurs catholiques, constitua une reconnaissance décisive et involontaire de l’importance de cette ingérence, que certaines personnes avaient d’abord censurée et méprisé, firent passer au second plan la voix sévère de l'opinion publique en Angleterre et ailleurs provoqua une suspension du massacre et du pillage ; les meurtriers et les pilleurs étaient toujours impunis, et même encensés et récompensés pour leurs crimes ; et tandis que les protestants de France souffraient des peines les plus cruelles et les plus dégradantes pour des crimes présumés insignifiants, des catholiques, couverts de sang et coupables de nombreux et horribles meurtres, furent acquittés.
Peut-être que la vertueuse indignation exprimée par certains des catholiques les plus éclairés contre ces actes abominables eut une part non négligeable dans leur diminution. De nombreux protestants innocents furent condamnés aux galères et punis pour des crimes 371
Le Livre des Martyrs de Foxe
présumés, sous serment des plus misérables et des plus abjectes des personnes. M. Madier de Mongau, juge de la cour royale de Nîmes, président de la cour d'Assises du Gard et du Vaucluse, à une occasion , se sentit obligé d’interrompre la cour, plutôt que de prendre la déposition de ce fameux et monstre sanguinaire, Truphémy : “ Dans une salle,” dit-il, “ du palais de justice, vis-à-vis de celle dans laquelle je me trouvais, plusieurs malheureux persécutés par la faction étaient en procès, chaque déposition tendant à leur condamnation était applaudie aux cris de “ Vive le Roi !”
Trois fois l'explosion de cette joie atroce est devenue si terrible qu'il était nécessaire d'envoyer des renforts de la caserne, et deux cents soldats étaient souvent incapables de contenir le peuple. Tout à coup, les cris et les clameurs de “ Vive le Roi !” redoublèrent : un homme était arrivé, encensé, applaudi, triomphant : c'était l'horrible Truphémy ; il s'approcha du tribunal : il était venu déposer contre les prisonniers ; il fut admis comme témoin et il leva la main pour prêter serment! Saisi d'horreur, je me précipitais hors de mon siège et entrais dans la salle du Conseil ; mes collègues me suivirent ; c’est en vain qu’ils essayèrent de me persuader de reprendre ma place ; “ Non!” m'écriai-je, je ne consentirai pas à ce que ce misérable soit admis à témoigner devant une Cour de justice de la ville dans laquelle il a commis tant d’assassinats ; dans le palais, sur les marches duquel il a assassiné l'infortuné Bourillon. Je ne peux pas admettre qu'il tue à nouveau ses victimes par ses faux-témoignages après l’avoir fait avec ses poignards. Lui un accusateur! Lui un témoin! Non, je n'accepterai jamais de voir ce monstre se lever, en présence de magistrats, pour prêter un serment sacrilège, la main toujours imbibée de sang. Ces mots furent répétés à l’extérieur ; le témoin tremblait ; les commanditaires tremblaient aussi ; ceux-là même qui guidaient la langue de Truphémy comme ils avaient dirigé son bras, qui dictaient la calomnie après qu'ils lui aient appris le meurtre. Ces mots pénétrèrent dans les donjons des condamnés et inspirèrent l'espoir ; ils donnèrent à un autre avocat courageux la résolution d'épouser la cause des persécutés ; il porta les prières de l'innocence et de la misère au pied du trône ; là, il demanda si le témoignage d’un Truphémy n'était pas suffisant pour annuler une condamnation. Le roi accorda une grâce complète et gratuite.”
Résolution ultime des protestants à Nîmes. S'agissant de la conduite des protestants, ces citoyens extrêmement indignés, poussés à l'extrême par leurs persécuteurs, ont finalement estimé qu'ils n'avaient plus qu’à choisir la manière dont ils devaient périr. Ils décidèrent unanimement qu'ils mourraient en combattant pour leur propre défense. Cette attitude ferme envoya un signal à leurs bourreaux qu'ils ne pouvaient plus assassiner impunément. Tout changea immédiatement. Ceux qui, pendant quatre ans, avaient rempli les autres de terreur, la sentaient maintenant à leur tour. Ils tremblaient devant la force que les hommes, si longtemps résignés, trouvèrent dans le désespoir, et leur inquiétude fut encore plus grande lorsqu'ils apprirent que les habitants des Cévennes, persuadés du danger de leurs frères, marchaient à leur secours. Mais, sans attendre ces renforts, les protestants paraissaient la nuit dans le même ordre et armés de la même manière que leurs ennemis. Les autres défilèrent 372

Le Livre des Martyrs de Foxe
dans les boulevards, avec leur bruit et leur fureur habituels, mais les protestants restèrent silencieux et fermes dans les postes qu'ils avaient choisis. Pendant trois jours, ces réunions dangereuses et menaçantes se poursuivirent ; mais l'effusion de sang fut empêchée par les efforts de quelques citoyens dignes, distingués par leur rang et leur fortune. En partageant les dangers qui menaçaient la population protestante, ils obtinrent la grâce d'un ennemi qui tremblait alors qu'il était menacé.
373
Le Livre des Martyrs de Foxe
Chapitre XXV - Les Débuts des Missions Étrangères Américaines Samuel J. Mills, lorsqu'il était étudiant au Williams Collège, rassemblait autour de lui un groupe d'étudiants, tous sensibles au fardeau du grand monde païen. Un jour de 1806, quatre d'entre eux, surpris par un orage, se réfugièrent à l'abri d'une meule de foin. Ils passèrent leur temps à prier pour le salut du monde et décidèrent, si l'occasion se présentait, de partir eux-mêmes comme missionnaires. Cette "réunion de prière dans une meule de foin" est devenue historique.
Ces jeunes hommes se rendirent ensuite au séminaire théologique d'Andover, où Adoniram Judson les rejoignit. Quatre d'entre eux envoyèrent une pétition à l'Association congrégationaliste du Massachusetts à Bradford, le 29 juin 1810, se proposant comme missionnaires et demandant s'ils pouvaient espérer un soutien d'une société dans ce pays, ou s'ils devaient s'adresser à une société britannique. En réponse à cet appel, « American Board of Commissioners for Foreign Missions » a été créé.
Lorsqu'une charte pour le Conseil a été demandée, une âme incrédule s'y est opposée à l'assemblée législative, alléguant que le pays contenait une réserve de christianisme si limitée qu'on ne pouvait pas en épargner pour l'exportation, mais un autre, qui avait la chance d'être plus optimiste, lui a rappelé avec justesse que c'était une marchandise telle que plus on en envoyait à l'étranger, plus il en restait chez soi. Il y avait beaucoup de perplexité concernant les plans et les finances, aussi Judson fut-il envoyé en Angleterre pour s'entretenir avec la Société de Londres de la possibilité pour les deux organisations de coopérer pour envoyer et soutenir les candidats, mais ce projet n'aboutit à rien. Finalement, des fonds suffisants furent réunis et, en février 1812, les premiers missionnaires de l'American Board s'embarquèrent pour l'Orient. M. Judson était accompagné de sa femme, ayant épousé Ann Hasseltine peu avant le départ.
Au cours du long voyage, M. et Mme Judson et M. Rice ont été amenés, d'une manière ou d'une autre, à réviser leurs convictions en ce qui concerne le mode de baptême approprié, à conclure que seule l'immersion était valide et à se faire rebaptiser par Carey peu après leur arrivée à Calcutta. Cette démarche a nécessairement rompu leur lien avec l'organisme qui les avait envoyés, et les a laissés complètement démunis de soutien. M. Rice retourna en Amérique pour rapporter cette situation aux frères baptistes. Ceux-ci considérèrent la situation comme le résultat d'un acte de la Providence et envisagèrent avec enthousiasme d'accepter la responsabilité qui leur incombait. C'est ainsi que fut créée le « Baptist Missionary Union ».
Ainsi, M. Judson fut l'occasion de l'organisation de deux grandes sociétés missionnaires.
La Persécution du Docteur Judson
Après avoir travaillé quelque temps en Hindoustan, le Dr. et Mme. Judson s'établirent finalement à Rangoon, dans l'Empire birman, en 1813. En 1824, une guerre éclate entre la Compagnie britannique des Indes orientales et l'empereur de Birmanie. Le Dr et Mme Judson et le Dr Price, qui se trouvaient à Ava, la capitale de l'Empire birman, lorsque la guerre a 374
Le Livre des Martyrs de Foxe
commencé, ont été immédiatement arrêtés et emprisonnés pendant plusieurs mois. Le récit des souffrances des missionnaires a été écrit par Mme Judson et est donné dans ses propres termes.
Rangoon,
le 26 mai 1826.
Mon frère bien-aimé,
Je commence cette lettre avec l'intention de vous donner les détails de notre captivité et de nos souffrances à Ava. Combien de temps ma patience me permettra-t-elle de revoir des scènes de dégoût et d'horreur, la conclusion de cette lettre le déterminera. J'avais tenu un journal de tout ce qui s'était passé depuis notre arrivée à Ava, mais je l'ai détruit à l'apparition de nos difficultés.
La première information certaine que nous reçûmes de la déclaration de guerre des Birmans fut à notre arrivée à Tsenpyoo-kywon, à environ cent milles de Ava, où une partie des troupes, sous le commandement du célèbre Bandoola, avait campé. Alors que nous poursuivions notre voyage, nous avons rencontré Bandoola lui-même, avec le reste de ses troupes, gaiement équipé, assis sur sa barge d'or, et entouré d'une flotte de bateaux de guerre en or, dont l'un a été immédiatement envoyé de l'autre côté de la rivière pour nous saluer, et faire toutes les enquêtes nécessaires. Nous avons été autorisés à poursuivre tranquillement notre route, après qu'il eut informé le messager que nous étions des Américains, et non des Anglais, et que nous nous rendions à Ava pour obéir à l'ordre de sa Majesté.
À notre arrivée dans la capitale, nous avons constaté que le Dr Price était mal vu à la cour et que la plupart des étrangers présents à Ava étaient soupçonnés. Votre frère s'est rendu au palais deux ou trois fois, mais il a constaté que les manières du roi à son égard étaient très différentes de ce qu'elles avaient été auparavant ; et la reine, qui avait jusqu'alors exprimé le souhait que j'arrive rapidement, ne s'est pas enquise de moi et n'a pas manifesté le désir de me voir. Par conséquent, je n'ai fait aucun effort pour visiter le palais, bien que je sois presque quotidiennement invité à rendre visite à certaines branches de la famille royale, qui vivaient dans leurs propres maisons, hors de l'enceinte du palais. Dans ces circonstances, nous avons pensé que le plus prudent était de poursuivre notre intention initiale de construire une maison et de commencer des opérations missionnaires lorsque l'occasion se présentait, afin de convaincre le gouvernement que nous n'avions vraiment rien à voir avec la guerre actuelle.
Deux ou trois semaines après notre arrivée, le roi, la reine, tous les membres de la famille royale et la plupart des officiers du gouvernement sont retournés à Amarapora, afin de venir prendre possession du nouveau palais dans le style habituel.
Je n'ose pas tenter une description de ce jour splendide, où la majesté, avec toute la gloire qui l'accompagne, franchit les portes de la ville d'or, et au milieu des acclamations de millions de personnes, je peux dire, prit possession du palais. Les saupoudres des provinces limitrophes 375
Le Livre des Martyrs de Foxe
de la Chine, tous les vice-rois et les hauts fonctionnaires du royaume étaient réunis pour l'occasion, vêtus de leurs robes d'État et ornés des insignes de leur fonction. L'éléphant blanc, richement orné d'or et de bijoux, était l'un des plus beaux objets du cortège. Le roi et la reine seuls étaient sans ornement, vêtus de la simple tenue du pays ; ils entrèrent, main dans la main, dans le jardin où nous avions pris place, et où un banquet était préparé pour leur rafraîchissement. Toutes les richesses et toute la gloire de l'empire étaient en ce jour exposées aux regards. Le nombre et la taille immense des éléphants, les nombreux chevaux, et la grande variété de véhicules de toutes sortes, surpassaient de loin tout ce que j'ai jamais vu ou imaginé.
Peu de temps après que sa majesté ait pris possession du nouveau palais, un ordre a été émis pour qu'aucun étranger ne soit autorisé à entrer, à l'exception de Lansago. Nous avons été un peu alarmés par cette décision, mais nous avons conclu qu'elle était motivée par des raisons politiques et qu'elle ne nous affecterait peut-être pas essentiellement.
Pendant plusieurs semaines, rien ne s'est produit pour nous alarmer, et nous avons continué notre école. M. J. prêchait tous les sabbats, tous les matériaux nécessaires à la construction d'une maison en briques étaient achetés, et les maçons avaient fait des progrès considérables dans la construction du bâtiment.
"Le 23 mai 1824, alors que nous venions de terminer le culte chez le docteur, de l'autre côté de la rivière, un messager vint nous informer que Rangoon était prise par les Anglais.
Cette information produisit un choc, dans lequel se mêlaient la crainte et la joie. M. Gouger, un jeune marchand résidant à Ava, était alors avec nous, et avait beaucoup plus de raisons de craindre que le reste d'entre nous. Cependant, nous sommes tous immédiatement retournés à la maison et avons commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire. M. G. se rendit chez le prince Thar-yar-wadee, le frère le plus influent du roi, qui l'informa qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car il avait mentionné le sujet à Sa Majesté, qui avait répondu que "les quelques étrangers résidant à Ava n'avaient rien à voir avec la guerre et ne devaient pas être molestés".
Le gouvernement était maintenant tout en mouvement. Une armée de dix ou douze mille hommes, sous le commandement du Kyee-woon-gyee, fut envoyée dans trois ou quatre jours, et devait être rejointe par le Sakyer-woon-gyee, qui avait été nommé auparavant vice-roi de Rangoon, et qui s'y rendait, lorsque la nouvelle de son attaque lui parvint. La défaite des Anglais ne faisait aucun doute ; la seule crainte du roi était que les étrangers, apprenant l'avance des troupes birmanes, ne soient alarmés au point de s'enfuir à bord de leurs navires et de s'en aller, avant qu'il soit temps de les capturer comme esclaves. Faites venir pour moi, dit un jeune mâle sauvage du palais, six kala pyoo (étrangers blancs) pour ramer sur mon bateau ; et pour moi, dit la dame de Woon-Gyee, envoyez quatre étrangers blancs pour gérer les affaires de ma maison, car je crois savoir qu'ils sont de fidèles serviteurs. Les bateaux de guerre, en pleine allégresse, passèrent devant notre maison, les soldats chantant et dansant, et faisant les gestes les plus joyeux. Pauvres gars ! disions-nous, vous ne danserez probablement plus jamais. Et il en fut ainsi, car rares furent ceux qui revirent leur maison natale.
376
Le Livre des Martyrs de Foxe
"Finalement, M. Judson et le Dr Price furent convoqués devant une cour d'examen, où une enquête rigoureuse fut menée sur tout ce qu'ils savaient. Le point essentiel semblait être de savoir s'ils avaient eu l'habitude de faire des communications aux étrangers, sur l'état du pays, etc. Ils répondirent qu'ils avaient toujours écrit à leurs amis en Amérique, mais qu'ils n'avaient aucune correspondance avec les officiers anglais ou le gouvernement du Bengale.
Après leur examen, ils n'ont pas été mis en détention comme l'avaient été les Anglais, mais ont été autorisés à retourner dans leurs maisons. En examinant les comptes de M. G., on s'aperçut que M. J. et le Dr Price lui avaient pris beaucoup d'argent. Ignorant, comme l'étaient les Birmans, notre façon de recevoir de l'argent, par des ordres sur le Bengale, cette circonstance, pour leurs esprits soupçonneux, était une preuve suffisante que les missionnaires étaient à la solde des Anglais, et très probablement des espions. Elle fut ainsi représentée au roi, qui, sur un ton de colère, ordonna l'arrestation immédiate des " deux professeurs .
Le 8 juin, au moment où nous nous préparions à dîner, un officier, tenant un livre noir, arriva en trombe avec une douzaine de Birmans, accompagnés d'un homme que, d'après son visage tacheté, nous savions être un bourreau et un "fils de la prison". Où est le professeur ?
" fut la première question. M. Judson s'est présenté. Vous êtes appelé par le roi", dit l'officier, une formule toujours utilisée lorsqu'on est sur le point d'arrêter un criminel. L'homme tacheté s'empare instantanément de M. Judson, le jette à terre et lui présente la petite corde, l'instrument de torture. Je saisis son bras ;
Reste, (dis-je,) je vais te donner de l'argent. Prenez-la aussi, dit l'officier, elle est aussi une étrangère. M. Judson, avec un regard implorant, les a suppliés de me laisser rester jusqu'à nouvel ordre. La scène était maintenant choquante au-delà de toute description.
Tout le voisinage s'était rassemblé - les maçons qui travaillaient à la construction de la maison en briques jetèrent leurs outils et s'enfuirent - les petits enfants birmans criaient et pleuraient - les serviteurs bengalis étaient stupéfaits de l'indignité offerte à leur maître - et le bourreau endurci, avec une joie infernale, tira les cordes, lia solidement M. Judson et le traîna, je ne sais où. En vain, je priai et suppliai le visage tacheté de prendre l'argent et de relâcher les cordes, mais il repoussa mes offres et s'en alla immédiatement. Je donnai cependant l'argent à Moung Ing pour qu'il le suive et tente d'atténuer le supplice de M. Judson ; mais, au lieu de réussir, à quelques pas de la maison, les misérables insensibles jetèrent de nouveau leur prisonnier sur le sol et resserrèrent encore les cordes, au point d'empêcher presque toute respiration.
"L'officier et sa bande se rendirent au palais de justice, où se trouvaient le gouverneur de la ville et les officiers, et où l'un d'eux lut l'ordre du roi d'envoyer M. Judson dans la prison de la mort, où il fut bientôt jeté, la porte fermée et Moung Ing ne vit plus rien. Quelle nuit s'ouvrait devant moi ! Je me retirai dans ma chambre, et je m'efforçai de me consoler en confiant mon cas à Dieu, et en implorant la force et le courage de souffrir tout ce qui m'attendait. Mais la consolation de la retraite ne me fut pas longtemps accordée, car le magistrat de l'endroit était entré dans la véranda, et me demandait sans cesse de sortir, et de 377
Le Livre des Martyrs de Foxe
me soumettre à son examen. Mais avant de sortir, je détruisis toutes mes lettres, journaux et écrits de toute sorte, de peur qu'ils ne révèlent le fait que nous avions des correspondants en Angleterre, et que nous avions consigné tous les événements depuis notre arrivée dans le pays.
Lorsque ce travail de destruction fut terminé, je sortis et me soumis à l'examen du magistrat, qui s'enquit très minutieusement de tout ce que je savais ; il ordonna ensuite de fermer les portes de l'enceinte, de ne permettre à personne d'y entrer ou d'en sortir, de placer une garde de dix ruffians, à qui il donna l'ordre strict de veiller à la sécurité de l'enceinte et il quitta.
"Il faisait maintenant nuit. Je me suis retiré dans une pièce intérieure avec mes quatre petites filles birmanes, et j'ai barré les portes. Les gardes m'ont immédiatement ordonné d'ouvrir les portes et de sortir, ou ils allaient démolir la maison. Je refusai obstinément d'obéir et m'efforçai de les intimider en menaçant de me plaindre de leur conduite aux autorités supérieures le lendemain. Me trouvant résolu à désobéir à leurs ordres, ils prirent les deux serviteurs bengalais et les enfermèrent dans les ceps dans une position très douloureuse. Je n'ai pas pu supporter cela, mais j'ai appelé le chef à la fenêtre, et j'ai promis de leur faire un cadeau à tous le matin, s'ils libéraient les domestiques. Après bien des discussions et des menaces sévères, ils consentirent, mais semblaient résolus à m'ennuyer le plus possible. Mon absence de protection, mon état de désolation, mon incertitude totale quant au sort de M.
Judson, les effroyables carrousels et le langage presque diabolique des gardes, tout concourait à faire de cette nuit la plus pénible que j'aie jamais passée. Vous pouvez imaginer, mon cher frère, que le sommeil était étranger à mes yeux, et la paix et la sérénité à mon esprit.
"Le lendemain matin, j'envoyai Moung Ing s'enquérir de la situation de votre frère et lui donner à manger, s'il vivait encore. Il revint bientôt, avec l'information que M. Judson et tous les étrangers blancs étaient enfermés dans la prison de la mort, avec trois paires d'entraves en fer chacun, et attachés à un long poteau, pour les empêcher de bouger ! Le point culminant de mon angoisse était que j'étais moi-même prisonnier, et que je ne pouvais faire aucun effort pour la libération des missionnaires. J'ai supplié et imploré le magistrat de me permettre d'aller voir un membre du gouvernement pour lui exposer mon cas, mais il a dit qu'il n'osait pas y consentir, de peur que je ne m'échappe. J'écrivis ensuite un mot à l'une des sœurs du roi, avec laquelle j'avais été intime, la priant d'user de son influence pour la libération des enseignants.
La note m'a été retournée avec ce message : " Elle ne l'a pas compris ", ce qui était un refus poli d'intervenir, bien que je me sois assuré par la suite qu'elle désirait ardemment nous aider, mais qu'elle n'osait pas le faire à cause de la reine. La journée s'écoula lourdement, et une autre nuit épouvantable était devant moi. Je m'efforçai d'adoucir les sentiments des gardes en leur donnant du thé et des cigares pour la nuit, de sorte qu'ils me permirent de rester dans ma chambre, sans me menacer comme ils l'avaient fait la nuit précédente. Mais l'idée de votre frère étendu sur le sol nu, dans les fers et la réclusion, hantait mon esprit comme un spectre, et m'empêchait d'obtenir un sommeil tranquille, bien que la nature fût presque épuisée.
"Le troisième jour, j'ai envoyé un message au gouverneur de la ville, qui a l'entière direction des affaires de la prison, pour qu'il me permette de lui rendre visite avec un cadeau.
378
Le Livre des Martyrs de Foxe
Cela eut l'effet désiré, et il envoya immédiatement des ordres aux gardes pour me permettre d'aller en ville. Le gouverneur me reçut agréablement, et me demanda ce que je voulais. Je lui exposai la situation des étrangers, et en particulier celle des professeurs, qui étaient américains et n'avaient rien à voir avec la guerre.
Il me dit qu'il n'était pas en son pouvoir de les libérer de la prison ou des fers, mais qu'il pouvait rendre leur situation plus confortable ; il y avait son officier en chef, avec qui je devais consulter, relativement aux moyens. L'officier, qui s'avéra être l'un des écrivains de la ville, et dont le visage présentait au premier coup d'œil l'assemblage le plus parfait de toutes les mauvaises passions attachées à la nature humaine, me prit à part, et s'efforça de me convaincre que moi-même, ainsi que les prisonniers, étions entièrement à sa disposition - que notre confort futur devait dépendre de ma libéralité en matière de cadeaux - et que ceux-ci devaient être faits d'une manière privée et inconnue de tout officier du gouvernement ! Que dois-je faire, lui dis-je, pour obtenir une atténuation des souffrances actuelles des deux professeurs ?
Payez-moi, me dit-il, deux cents tickals (environ cent dollars), deux pièces d'étoffe fine et deux mouchoirs. J'avais emporté de l'argent le matin, notre maison étant à deux milles de la prison, je ne pouvais pas revenir facilement. J'ai offert cet argent à l'écrivain, en le priant de ne pas insister sur les autres articles, puisqu'ils n'étaient pas en ma possession. Il a hésité pendant un certain temps, mais craignant de perdre la vue d'une telle somme d'argent, il a décidé de la prendre, promettant de soulager les enseignants de leur situation la plus douloureuse.
"J'obtins alors du gouverneur un ordre d'admission en prison, mais je n'essaierai pas de rendre compte des sensations produites par la rencontre de votre frère dans cette situation misérable et horrible, ni de la scène émouvante qui s'ensuivit. M. Judson s'est traîné jusqu'à la porte de la prison - car on ne m'a jamais permis d'y entrer - et m'a donné quelques instructions relatives à sa libération ; mais avant que nous ayons pu prendre quelque disposition que ce soit, j'ai reçu l'ordre de partir, par ces geôliers au cœur de fer, qui ne pouvaient supporter de nous voir jouir de la pauvre consolation de nous rencontrer dans ce lieu misérable.
En vain, j'invoquai l'ordre du gouverneur pour me faire admettre ; ils répétèrent durement
: "Partez, ou nous vous ferons sortir". Le même soir, les missionnaires, ainsi que les autres étrangers, qui avaient payé une somme égale, furent sortis de la prison commune et enfermés dans un hangar ouvert dans l'enceinte de la prison. Là, j'ai été autorisé à leur envoyer de la nourriture et des nattes pour dormir, mais je n'ai pas été autorisé à y retourner avant plusieurs jours.
"Mon prochain objectif était de faire présenter une pétition à la reine ; mais personne n'étant admis dans le palais, qui soit en disgrâce avec sa majesté, j'ai cherché à la présenter par l'intermédiaire de la femme de son frère. Je lui avais rendu visite dans des jours meilleurs, et j'avais reçu des marques particulières de sa faveur. Mais maintenant les temps ont changé : M. Judson était en prison, et moi dans la détresse, ce qui était une raison suffisante pour me 379
Le Livre des Martyrs de Foxe
réserver un accueil froid. J'ai pris un cadeau d'une valeur considérable. Elle se prélassait sur son tapis lorsque je suis entré, entourée de ses serviteurs. Je n'attendis pas la question habituelle adressée à un suppliant : "Que voulez-vous ?" mais, d'une manière audacieuse, sérieuse, mais respectueuse, j'exposai nos détresses et nos torts, et implorai son aide. Elle leva partiellement la tête, ouvrit le cadeau que j'avais apporté, et répondit froidement : " Votre cas n'est pas singulier ; tous les étrangers sont traités de la même façon. Mais il est singulier, dis-je, les professeurs sont Américains ; ils sont ministres du culte, n'ont rien à voir avec la guerre ou la politique, et sont venus à Ava pour obéir à l'ordre du roi. Ils n'ont jamais rien fait pour mériter un tel traitement ; est-il juste qu'ils soient traités ainsi ?" "Le roi fait ce qu'il veut", dit-elle ; "Je ne suis pas le roi, que puis-je faire ?" "Vous pouvez exposer leur cas à la reine et obtenir leur libération", répondis-je. "Mettez-vous à ma place - si vous étiez en Amérique, votre mari, innocent de tout crime, jeté en prison, aux fers, et vous une femme solitaire et sans protection - que feriez-vous ?"
Avec un peu d'émotion, elle a dit : "Je vais présenter votre requête, revenez demain. Je suis retourné à la maison, avec l'espoir considérable que la libération rapide des missionnaires était à portée de main. Mais le lendemain, les biens de M. Gouger, d'un montant de cinquante mille dollars, ont été pris et transportés au palais. Les officiers, à leur retour, m'ont poliment informé qu'ils devaient visiter notre maison le lendemain. Je me suis senti obligé de cette information et j'ai donc fait des préparatifs pour les recevoir, en cachant autant de petits articles que possible, ainsi qu'une quantité considérable d'argent, car je savais que, si la guerre devait se prolonger, nous serions dans un état de famine sans cela. Mais mon esprit était dans un état d'agitation épouvantable, de peur qu'il ne soit découvert et que je sois jeté en prison.
Et s'il avait été possible de se procurer de l'argent d'un autre côté, je ne me serais pas aventuré dans une telle démarche.
Le lendemain matin, le trésorier royal, le prince Tharyawadees, le chef Woon et Koung-tone Myoo-tsa, qui était désormais notre ami fidèle, accompagnés de quarante ou cinquante partisans, vinrent prendre possession de tout ce que nous avions. Je les traitai avec civilité, leur donnai des chaises pour s'asseoir, du thé et des friandises pour se rafraîchir, et la justice m'oblige à dire qu'ils menèrent l'affaire de la confiscation avec plus d'égards pour mes sentiments que je n'aurais cru possible à des officiers birmans d'en faire preuve. Les trois officiers, avec l'un des secrétaires royaux, entrèrent seuls dans la maison ; leurs préposés reçurent l'ordre de rester dehors. Ils virent que j'étais profondément affecté, et s'excusèrent de ce qu'ils allaient faire, en disant qu'il leur était pénible de prendre possession de biens qui ne leur appartenaient pas, mais qu'ils y étaient contraints par ordre du roi.
"'Où sont votre argent, votre or et vos bijoux ?' dit le trésorier royal. Je n'ai ni or ni bijoux, mais voici la clé d'un coffre qui contient l'argent - faites-en ce que vous voulez. La malle fut présentée, et l'argent pesé. Cet argent, dis-je, a été collecté en Amérique, par les disciples du Christ, et envoyé ici dans le but de construire un kyoung (nom de l'habitation d'un prêtre) et pour notre soutien pendant que nous enseignons la religion du Christ. Est-il convenable que 380
Le Livre des Martyrs de Foxe
vous le preniez ? (Les Birmans répugnent à prendre ce qui leur est offert au point de vue religieux, ce qui fut la cause de ma demande). Nous ferons part de cette circonstance au roi, dit l'un d'eux, et peut-être le restituera-t-il. Mais c'est là tout l'argent que vous avez ? Je ne pouvais pas dire un mensonge : "La maison est en votre possession, répondis-je, cherchez par vous-mêmes. N'avez-vous pas déposé de l'argent chez quelqu'un de votre connaissance ? Mes connaissances sont toutes en prison, chez qui pourrais-je déposer de l'argent ?
Ils ont ensuite ordonné l'examen de ma malle et de mes tiroirs. Seul le secrétaire était autorisé à m'accompagner dans cette fouille. Tout ce qui était beau ou curieux et qui répondait à ses critères était présenté aux officiers qui décidaient s'il fallait le prendre ou le garder. Je les ai suppliés de ne pas prendre nos vêtements, car il serait honteux de prendre des vêtements partiellement portés en possession de sa majesté, et pour nous ils étaient d'une valeur inestimable. Ils ont accepté et n'ont pris qu'une liste, et ont fait de même avec les livres, les médicaments, etc. J'ai sauvé de leur emprise ma petite table de travail et ma chaise à bascule, cadeaux de mon frère bien-aimé, en partie par artifice et en partie grâce à leur ignorance. Ils ont également laissé de nombreux articles d'une valeur inestimable pendant notre longue détention.
Dès qu'ils eurent terminé leurs recherches et qu'ils furent partis, je m'empressai d'aller trouver le frère de la reine pour savoir ce qu'il était advenu de ma requête ; mais, hélas, toutes mes espérances furent anéanties par sa femme qui me dit froidement : J'ai exposé votre cas à la reine, mais sa majesté m'a répondu : Les maîtres ne mourront pas, laissez-les tels qu'ils sont. Mes espérances avaient été tellement excitées que cette phrase fut comme un coup de foudre pour mes sentiments. Car la vérité d'un seul coup d'œil m'assurait que si la reine refusait son aide, qui oserait intercéder pour moi ? Le cœur lourd, je suis parti et, sur le chemin du retour, j'ai essayé de franchir la porte de la prison pour annoncer la triste nouvelle à votre frère, mais on m'a sévèrement refusé l'entrée, et pendant les dix jours qui ont suivi, malgré mes efforts quotidiens, je n'ai pas été autorisé à entrer. Nous avons essayé de communiquer par écrit, et après avoir réussi pendant quelques jours, cela a été découvert ; le pauvre garçon qui portait les communications a été battu et mis au pilori ; et la circonstance m'a coûté environ dix dollars, en plus de deux ou trois jours d'agonie, par crainte des conséquences.
Les officiers qui avaient pris possession de nos biens, les présentèrent à sa majesté, en disant : " Judson est un vrai professeur ; nous n'avons rien trouvé dans sa maison, que ce qui appartient aux prêtres. Outre cet argent, il y a un nombre immense de livres, de médicaments, de malles d'habillement, dont nous n'avons pris que la liste. Les prenons-nous ou les laissons-nous ? "
" Laissez-les, dit le roi, et mettez ce bien à part, car il lui sera restitué s'il est reconnu innocent ". C'était une allusion à l'idée qu'il était un espion.
381
Le Livre des Martyrs de Foxe
Pendant les deux ou trois mois qui suivirent, je fus soumis à des tracasseries continuelles, en partie à cause de mon ignorance de la gestion de la police et en partie à cause du désir insatiable de chaque petit officier de s'enrichir par nos malheurs.
Vous, mon cher frère, qui connaissez mon vif attachement pour mes amis, et combien de plaisir j'ai éprouvé jusqu'ici par la rétrospective, vous pouvez juger, d'après les circonstances ci-dessus, combien mes souffrances étaient intenses. Mais le point, l'acmé de mes détresses, consistait dans l'affreuse incertitude de notre sort final. L'opinion qui prévalait était que mon mari subirait une mort violente ; et que je deviendrais, bien sûr, une esclave, et que je languirais pendant une existence misérable mais courte, entre les mains tyranniques de quelque monstre insensible. Mais les consolations de la religion, dans ces circonstances éprouvantes, n'étaient ni "rares ni petites". Elle m'a appris à regarder au-delà de ce monde, vers ce repos, ce repos paisible et heureux, où Jésus règne et où l'oppression n'entre jamais.
Quelques mois après l'emprisonnement de votre frère, j'ai été autorisé à aménager une petite pièce en bambou dans l'enceinte de la prison, où il pouvait être seul, et où j'étais parfois autorisé à passer deux ou trois heures. Il se trouve que les deux mois qu'il a passés dans cette pièce ont été la période la plus froide de l'année, alors qu'il aurait beaucoup souffert dans le hangar ouvert qu'il occupait auparavant. Après la naissance de votre petite nièce, je n'ai pas pu rendre visite à la prison et au gouverneur comme auparavant, et j'ai constaté que j'avais perdu l'influence considérable que j'avais acquise auparavant, car il n'était pas aussi disposé à écouter mes requêtes lorsqu'une difficulté se présentait, comme il l'avait été auparavant.
Lorsque Maria eut presque deux mois, son père m'envoya un matin la nouvelle que lui et tous les prisonniers blancs avaient été placés dans la prison intérieure, avec cinq paires d'entraves chacun, que sa petite chambre avait été démolie et que les geôliers avaient pris sa natte, son oreiller, etc. Ce fut pour moi un choc épouvantable, car je pensai tout de suite que ce n'était que le prélude à de plus grands maux.
"La situation des prisonniers était maintenant bouleversante au-delà de toute description.
C'était le début de la saison chaude. Il y avait plus de cent prisonniers enfermés dans une seule pièce, sans un souffle d'air, si ce n'est par les fissures des planches. J'obtenais parfois la permission d'aller à la porte pendant cinq minutes, et mon cœur se serrait devant la misère qui s'y manifestait.
Les prisonniers blancs, à cause de leur transpiration incessante et de leur perte d'appétit, ressemblaient plus à des morts qu'à des vivants. Je faisais chaque jour des démarches auprès du gouverneur, lui offrant de l'argent, ce qu'il refusait ; mais tout ce que j'obtenais, c'était la permission pour les étrangers de prendre leur nourriture à l'extérieur, et cela ne dura que peu de temps.
"Après avoir continué à vivre dans la prison intérieure pendant plus d'un mois, votre frère fut pris de fièvre. Je fus assuré qu'il ne vivrait pas longtemps, à moins d'être retiré de ce lieu bruyant. Pour cela, et pour être près de la prison, j'ai quitté notre maison et j'ai installé une 382
Le Livre des Martyrs de Foxe
petite chambre en bambou dans l'enceinte du gouverneur, qui était presque en face de la porte de la prison. Là, je suppliai sans cesse le gouverneur de me donner l'ordre de sortir M. J. de la grande prison et de le placer dans une situation plus confortable ; et le vieil homme, épuisé par mes supplications, me donna finalement l'ordre sous une forme officielle ; il donna également l'ordre au geôlier en chef de me permettre d'entrer et de sortir à toute heure du jour pour administrer des médicaments. Je me sentais maintenant heureux, en effet, et j'ai fait transférer instantanément M. J. dans une petite masure de bambou, si basse qu'aucun de nous ne pouvait se tenir debout - mais un palais en comparaison de l'endroit qu'il avait quitté.
Déplacement des Prisonniers à Oung-pen-la-Mme Judson les Suit
Malgré l'ordre que le gouverneur avait donné pour mon admission dans la prison, c'est avec la plus grande difficulté que j'ai pu persuader le sous-gardien d'ouvrir la porte. J'avais l'habitude de porter moi-même la nourriture de M. J. pour pouvoir entrer, et j'y restais une heure ou deux, à moins d'être chassé. Nous étions dans cette situation confortable depuis deux ou trois jours lorsqu'un matin, ayant porté le petit déjeuner de M. Judson, qu'il était incapable de prendre à cause de la fièvre, je suis resté plus longtemps que d'habitude, lorsque le gouverneur m'a fait venir en toute hâte. Je lui ai promis de revenir dès que je me serais assuré de la volonté du gouverneur, car il était très inquiet de ce message inhabituel. J'ai été agréablement déçu lorsque le gouverneur m'a informé qu'il souhaitait seulement me consulter au sujet de sa montre, et qu'il semblait inhabituellement agréable et plaisant. Je découvris par la suite que son seul but était de me retenir jusqu'à ce que la terrible scène qui allait se dérouler dans la prison soit terminée. En effet, lorsque je l'ai quitté pour me rendre dans ma chambre, l'un des serviteurs est arrivé en courant et m'a informé, avec une mine affreuse, que tous les prisonniers blancs avaient été emmenés.
Je ne voulus pas croire à cette nouvelle, mais je retournai immédiatement chez le gouverneur, qui me dit qu'il venait d'en entendre parler, mais qu'il ne voulait pas me le dire.
Je me précipitai dans la rue, espérant les apercevoir avant qu'ils ne soient hors de vue, mais je fus déçu. J'ai couru d'abord dans une rue, puis dans une autre, demandant à tous ceux que je rencontrais, mais personne ne voulait me répondre. Finalement, une vieille femme m'a dit que les prisonniers blancs étaient partis vers la petite rivière, car ils devaient être transportés à Amarapora. J'ai alors couru jusqu'aux rives de la petite rivière, à environ un demi-mille, mais je ne les ai pas vus, et j'ai conclu que la vieille femme m'avait trompé. Certains des amis des étrangers se sont rendus sur le lieu de l'exécution, mais ne les ont pas trouvés. Je suis alors retourné chez le gouverneur pour tenter de découvrir la cause de leur déplacement et la probabilité de leur sort futur. Le vieil homme m'a assuré qu'il ignorait jusqu'à ce matin l'intention du gouvernement de renvoyer les étrangers. Depuis que je suis sorti, il avait appris que les prisonniers avaient été envoyés à Amarapora, mais dans quel but, il ne le savait pas.
Je vais envoyer un homme immédiatement, dit-il, pour voir ce qu'il faut faire d'eux. Vous ne pouvez rien faire de plus pour votre mari, poursuivit-il, prenez soin de vous.
383
Le Livre des Martyrs de Foxe
Jamais auparavant je n'avais autant souffert de la peur en traversant les rues d'Ava. Les derniers mots du gouverneur, 'Prends soin de toi', m'ont fait soupçonner qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas. Je vis aussi qu'il avait peur de me voir aller dans les rues, et me conseilla d'attendre la nuit pour m'envoyer une charrette et un homme pour ouvrir les portes. J'ai pris deux ou trois malles contenant les articles les plus précieux, ainsi que le coffre à médicaments, pour les déposer dans la maison du gouverneur ; et après avoir confié la maison et les locaux à notre fidèle Moung Ing et à un serviteur bengali, qui a continué avec nous, (bien que nous ne puissions pas payer son salaire), j'ai pris congé, comme je le pensais alors, de notre maison à Ava pour toujours.
La journée était terriblement chaude, mais nous avons obtenu un bateau couvert, dans lequel nous étions relativement à l'aise, jusqu'à deux milles de la maison du gouvernement. Je me suis alors procuré une charrette, mais le mouvement violent, ainsi que la chaleur et la poussière épouvantables, m'ont rendu presque distrait. Mais quelle ne fut pas ma déception, en arrivant au palais de justice, de constater que les prisonniers avaient été expédiés deux heures auparavant et que je devais parcourir quatre milles de plus dans ce mode inconfortable avec la petite Maria dans mes bras, que j'avais tenue tout le long du chemin depuis Ava. Le charretier refusa d'aller plus loin ; et après avoir attendu une heure sous le soleil brûlant, je me procurai un autre chariot et me mis en route pour cet endroit que je n'oublierai jamais, Oung-pen-la. J'ai obtenu un guide du gouverneur et j'ai été conduit directement à la cour de la prison.
"Mais quelle scène de misère s'offrit à ma vue ! La prison était un vieux bâtiment en ruines, sans toit ; la clôture était entièrement détruite ; huit ou dix Birmans étaient au sommet du bâtiment, essayant de se faire une sorte d'abri avec des feuilles ; tandis que sous une petite protection basse, à l'extérieur de la prison, étaient assis les étrangers, enchaînés deux par deux, presque morts de souffrance et de fatigue. Les premiers mots de votre frère furent : "Pourquoi es-tu venu ? J'espérais que tu ne me suivrais pas, car tu ne peux pas vivre ici".
La nuit tombait maintenant. Je n'avais pas de rafraîchissement pour les prisonniers qui souffraient, ni pour moi, car j'avais prévu de me procurer tout ce qui était nécessaire au marché d'Amarapora, et je n'avais pas d'abri pour la nuit. J'ai demandé à l'un des geôliers si je pouvais installer une petite maison en bambou près des prisonniers ; il m'a répondu "Non, ce n'est pas la coutume". Je l'ai alors supplié de me procurer un abri pour la nuit, lorsque le lendemain, je pourrais trouver un endroit où vivre. Il me conduisit chez lui, où il n'y avait que deux petites pièces, l'une dans laquelle lui et sa famille vivaient, l'autre, qui était alors à moitié pleine de grains, qu'il m'offrit ; et dans ce petit endroit crasseux, je passai les six mois suivants dans la misère. Je me procurai de l'eau à moitié bouillie au lieu de mon thé et, épuisé par la fatigue, je m'allongeai sur une natte étendue sur le paddy et m'efforçai d'obtenir un peu de rafraîchissement en dormant. Le lendemain matin, votre frère me fit le récit suivant du traitement brutal qu'il avait reçu à sa sortie de prison.
384
Le Livre des Martyrs de Foxe
Dès que je fus sorti à l'appel du gouverneur, un des geôliers se précipita dans la petite chambre de M. J., le saisit brutalement par le bras, le tira à l'extérieur, le dépouilla de tous ses vêtements, à l'exception de la chemise et du pantalon, prit ses chaussures, son chapeau et toute sa literie, ôta ses chaînes, passa une corde autour de sa taille et le traîna jusqu'au palais de justice, où les autres prisonniers avaient été emmenés auparavant. Ils furent alors attachés deux par deux et remis entre les mains du Lamine Woon, qui les précéda à cheval, tandis que ses esclaves conduisaient les prisonniers, l'un d'eux tenant la corde qui reliait deux d'entre eux. C'était au mois de mai, un des mois les plus chauds de l'année, et il était onze heures du jour, de sorte que le soleil était vraiment intolérable.
Ils n'avaient fait qu'un demi-mille, lorsque les pieds de votre frère se couvrirent d'ampoules, et son agonie était si grande, même à cette première époque, qu'au moment où ils traversaient la petite rivière, il désirait se jeter à l'eau pour être délivré du malheur. Mais le péché attaché à un tel acte l'en empêchait. Ils avaient alors huit miles à parcourir. Le sable et le gravier étaient comme des charbons ardents pour les pieds des prisonniers, qui devinrent bientôt parfaitement dépourvus de peau ; et dans ce misérable état, ils étaient poussés par leurs conducteurs insensibles. L'état de faiblesse de M. J., dû à la fièvre et au fait qu'il n'avait pas pris de nourriture ce matin-là, le rendait moins apte à supporter de telles épreuves que les autres prisonniers.
À mi-chemin de leur voyage, alors qu'ils s'arrêtaient pour chercher de l'eau, votre frère supplia le Lamine Woon de lui permettre de monter son cheval sur un ou deux milles, car il ne pouvait aller plus loin dans cet état épouvantable. Mais un regard méprisant et malin fut la seule réponse qui lui fut faite. Il demanda alors au capitaine Laird, qui était attaché à lui, et qui était un homme fort et en bonne santé, de lui permettre de s'accrocher à son épaule, car il s'enfonçait rapidement. L'homme au grand cœur lui accorda cette permission pendant un mille ou deux, mais il trouva ensuite le fardeau supplémentaire insupportable. Juste à ce moment-là, le serviteur bengali de M. Gouger s'approcha d'eux, et voyant la détresse de votre frère, il enleva sa coiffe, qui était faite d'étoffe, la déchira en deux, en donna la moitié à son maître et l'autre moitié à M. Judson, qui l'enveloppa aussitôt autour de ses pieds blessés, car on ne leur permettait pas de se reposer même un instant. Le domestique offrit alors son épaule à M. J. et fut presque porté par lui le reste du chemin.
"Le Lamine Woon, voyant l'état de détresse des prisonniers et le fait que l'un d'entre eux était mort, décida qu'ils ne devaient pas aller plus loin cette nuit-là, sinon ils auraient été conduits jusqu'à Oung-pen-la le même jour. Un vieux hangar fut désigné pour les héberger pendant la nuit, mais sans même une natte ou un oreiller, ou quoi que ce soit pour les couvrir.
La curiosité de la femme du Lamine Woon l'incita à rendre visite aux prisonniers, dont la misère excitait considérablement sa compassion, et elle commanda des fruits, du sucre et des tamariniers pour leur rafraîchissement ; le lendemain matin, on leur prépara du riz, et aussi pauvre qu'il fût, il fut rafraîchissant pour les prisonniers, qui avaient été presque privés de nourriture la veille. Des charrettes furent également fournies pour leur transport, car aucun 385
Le Livre des Martyrs de Foxe
d'entre eux n'était capable de marcher. Pendant tout ce temps, les étrangers ignoraient totalement ce qu'ils allaient devenir ; et lorsqu'ils arrivèrent à Oung-pen-la, et qu'ils virent l'état de délabrement de la prison, ils conclurent immédiatement, tous ensemble, qu'ils étaient là pour être brûlés, conformément au rapport qui avait circulé auparavant à Ava. Ils se sont tous efforcés de se préparer à la terrible scène prévue, et ce n'est que lorsqu'ils ont vu les préparatifs de réparation de la prison qu'ils ont eu le moindre doute qu'une mort cruelle et prolongée les attendait. Je suis arrivé une heure ou deux après.
Le lendemain matin, je me levai et m'efforçai de trouver quelque chose qui ressemble à de la nourriture. Mais il n'y avait pas de marché, et rien à se procurer. Un des amis du Dr Price, cependant, apporta d'Amarapora du riz froid et du curry de légumes, qui, avec une tasse de thé de M. Lansago, constituèrent le petit déjeuner des prisonniers ; et pour le dîner, nous fîmes un curry de poisson salé séché, qu'un domestique de M. Gouger avait apporté. J'avais apporté avec moi tout l'argent que je pouvais commander dans le monde, caché sur moi ; vous pouvez donc juger de nos perspectives, si la guerre devait se prolonger. Mais notre Père céleste a été meilleur pour nous que nos craintes ; car malgré les extorsions constantes des geôliers, pendant les six mois que nous avons passés à Oung-pen- la, et les fréquentes difficultés auxquelles nous avons été confrontés, nous n'avons jamais vraiment souffert du manque d'argent, bien que fréquemment du manque de provisions, qui n'étaient pas disponibles.
C'est à cet endroit que mes souffrances corporelles personnelles ont commencé. Pendant que votre frère était enfermé dans la prison de la ville, on m'avait permis de rester dans notre maison, dans laquelle il me restait beaucoup de commodités, et ma santé se maintenait au-delà de toute espérance. Mais maintenant, je n'avais pas un seul article de commodité - pas même une chaise ou un siège d'aucune sorte, à l'exception d'un plancher en bambou. Le matin même de mon arrivée, Mary Hasseltine fut atteinte de la variole, de façon naturelle. Bien que très jeune, elle était la seule assistante dont je disposais pour prendre soin de la petite Maria.
Mais elle exigeait maintenant tout le temps que je pouvais consacrer à M. Judson, dont la fièvre continuait à sévir en prison et dont les pieds étaient si affreusement mutilés qu'il fut incapable de bouger pendant plusieurs jours.
Je ne savais que faire, car je ne pouvais obtenir aucune aide du voisinage, ni aucun médicament pour les malades, mais j'étais toute la journée à faire des allers-retours entre la maison et la prison, avec la petite Maria dans mes bras. Parfois, j'étais grandement soulagée en la laissant pendant une heure, lorsqu'elle dormait, auprès de son père, tandis que je retournais à la maison pour m'occuper de Mary, dont la fièvre était si forte qu'elle produisait du délire. Elle était si complètement couverte de variole qu'on ne distinguait pas les pustules.
Comme elle était dans la même petite chambre que moi, je savais que Maria la prendrait ; je l'inoculai donc d'un autre enfant, avant que celui de Marie ne soit arrivé à un état tel qu'il soit contagieux. En même temps, j'ai inoculé Abby et les enfants du geôlier, qui l'ont tous eu si légèrement qu'ils n'ont guère interrompu leurs jeux. Mais l'inoculation dans le bras de ma 386
Le Livre des Martyrs de Foxe
pauvre petite Maria ne prit pas - elle l'attrapa de Mary, et l'eut de la manière naturelle. Elle n'avait alors que trois mois et demi, et avait été une enfant très saine ; mais il fallut attendre plus de trois mois avant qu'elle ne se remette parfaitement des effets de cette affreuse maladie.
Vous vous souviendrez que je n'ai jamais eu la variole, mais que j'ai été vacciné avant de quitter l'Amérique. Comme j'ai été constamment exposé pendant si longtemps, il s'est formé près de cent pustules, alors que je n'avais aucun symptôme de fièvre, etc. Les enfants du geôlier ayant eu la variole si légèrement, par suite de l'inoculation, ma renommée fut répandue dans tout le village, et tous les enfants, jeunes et vieux, qui ne l'avaient pas eue auparavant, furent amenés pour être inoculés. Et bien que je ne connaisse rien de cette maladie ou de la façon de la traiter, je les ai tous inoculés à l'aide d'une aiguille, et je leur ai dit de faire attention à leur alimentation - toutes les instructions que je pouvais leur donner. La santé de M. Judson s'est progressivement rétablie et il s'est retrouvé dans une situation beaucoup plus confortable que lorsqu'il était dans la prison de la ville.
"Les prisonniers ont d'abord été enchaînés deux par deux, mais dès que les geôliers ont pu se procurer des chaînes en quantité suffisante, ils ont été séparés et chaque prisonnier n'avait qu'une seule paire. La prison fut réparée, une nouvelle clôture fut construite et un grand hangar aéré fut érigé devant la prison, où les prisonniers étaient autorisés à rester pendant la journée, mais enfermés dans la petite prison fermée la nuit. Tous les enfants se sont rétablis de la variole ; mais mes veilles et mes fatigues, ainsi que ma nourriture misérable et mon logement encore plus misérable, ont amené une des maladies du pays, qui est presque toujours fatale aux étrangers.
" Ma constitution semblait détruite, et en quelques jours, je devins si faible que je fus à peine capable de marcher jusqu'à la prison de M. Judson. Dans cet état débilitant, je suis parti en charrette pour Ava, afin de me procurer des médicaments et une nourriture appropriée, laissant la cuisinière me remplacer. Je suis arrivé à la maison en toute sécurité, et pendant deux ou trois jours, le trouble semblait s'être arrêté ; ensuite, il m'a attaqué violemment, au point que je n'avais plus aucun espoir de guérison - et mon anxiété était maintenant de retourner à Oung-pen-la pour mourir près de la prison. Ce fut avec la plus grande difficulté que j'obtins du gouverneur la boîte à pharmacie, et je n'avais alors personne pour m'administrer des médicaments. J'ai cependant réussi à obtenir du laudanum et, en prenant deux gouttes à la fois pendant plusieurs heures, j'ai réussi à maîtriser mes troubles au point de pouvoir monter à bord d'un bateau, bien que je sois si faible que je ne pouvais pas me tenir debout, et je me suis remis en route pour Oung-pen-la. Les quatre derniers milles furent parcourus dans ce pénible moyen de transport qu'est la charrette, et au milieu de la saison des pluies, lorsque la boue ensevelit presque les bœufs. Vous pouvez vous faire une idée de ce qu'est une charrette birmane si je vous dis que leurs roues ne sont pas construites comme les nôtres, mais sont simplement des planches rondes et épaisses avec un trou au milieu, à travers lequel pénètre un poteau qui soutient le corps.
387
Le Livre des Martyrs de Foxe
"Je venais d'atteindre Oung-pen-la lorsque mes forces semblaient entièrement épuisées.
Le bon cuisinier indigène est sorti pour m'aider à entrer dans la maison, mais mon apparence était si altérée et émaciée que le pauvre homme a fondu en larmes à la première vue. J'ai rampé sur la natte dans la petite pièce, dans laquelle j'ai été confiné pendant plus de deux mois, et je ne me suis jamais parfaitement remis, jusqu'à ce que j'arrive au camp anglais. À cette époque, alors que j'étais incapable de prendre soin de moi ou de M. Judson, nous serions morts tous les deux sans les soins fidèles et affectueux de notre cuisinière bengalie.
"Un cuisinier bengali ordinaire ne fait rien d'autre que de cuisiner, mais il semblait oublier sa caste, et presque ses propres besoins, dans ses efforts pour nous servir. Il fournissait, cuisinait et portait la nourriture de votre frère, puis revenait s'occuper de moi. Je l'ai souvent vu ne pas goûter à la nourriture avant la nuit, parce qu'il devait aller chercher du bois et de l'eau si loin, et pour que le dîner de M. Judson soit prêt à l'heure habituelle. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais demandé son salaire, et n'a jamais hésité un seul instant à aller n'importe où, ou à accomplir n'importe quel acte que nous lui demandions. C'est avec grand plaisir que je parle de la conduite fidèle de ce serviteur, qui est toujours parmi nous et qui, je l'espère, a été bien récompensé pour ses services.
"Notre chère petite Maria était la plus grande souffrante à cette époque, ma maladie la privant de sa nourriture habituelle, et ni une nourrice ni une goutte de lait ne pouvaient être procurées dans le village. En faisant des cadeaux aux geôliers, j'ai obtenu la permission pour M. Judson de sortir de prison et d'emmener la créature émaciée autour du village, pour quémander un peu de nourriture aux mères qui avaient de jeunes enfants. Ses cris la nuit étaient déchirants, alors qu'il était impossible de répondre à ses besoins. J'ai alors commencé à penser que l'affliction même de Job était venue sur moi. Lorsque j'étais en bonne santé, je pouvais supporter les diverses épreuves et vicissitudes par lesquelles j'étais appelé à passer.
Mais être confiné par la maladie, et incapable d'aider ceux qui m'étaient si chers, dans la détresse, c'était presque trop pour moi ; et s'il n'y avait pas eu les consolations de la religion, et la conviction assurée que chaque épreuve supplémentaire était ordonnée par un amour et une miséricorde infinis, j'aurais sombré sous mes souffrances accumulées. Parfois, nos geôliers semblaient un peu adoucis par notre détresse, et pendant plusieurs jours consécutifs, ils autorisaient M. Judson à venir à la maison, ce qui était pour moi une consolation indicible.
Puis, ils se montraient aussi inflexibles dans leurs exigences que si nous n'avions pas souffert et que nous étions dans l'abondance. Les désagréments, les extorsions et les oppressions auxquels nous avons été soumis pendant nos six mois de résidence à Oung-pen-la ne peuvent être ni énumérés ni décrits.
"Le moment arriva enfin de nous libérer de ce lieu détesté, la prison d'Oung-pen-la. Un messager de notre ami, le gouverneur de la porte nord du palais, qui était auparavant Koung-tone, Myoo-tsa, nous informa qu'un ordre avait été donné, le soir précédent, au palais, pour la libération de M. Judson. Le soir même, un ordre officiel nous parvenait ; et, le cœur joyeux, je me mis à préparer notre départ, tôt le lendemain matin. Mais un obstacle inattendu se 388
Le Livre des Martyrs de Foxe
présenta, qui nous fit craindre que je ne sois encore retenu comme prisonnier. Les geôliers avares, peu désireux de perdre leur proie, insistèrent pour que, mon nom ne figurant pas sur l'ordre, je ne parte pas. J'ai insisté en vain sur le fait que je n'avais pas été envoyé là en tant que prisonnier, et qu'ils n'avaient aucune autorité sur moi - ils ont quand même décidé que je ne devais pas partir, et ont interdit aux villageois de me laisser une charrette. M. Judson fut alors sorti de prison et amené à la maison du geôlier, où, à force de promesses et de menaces, il obtint finalement leur consentement, à condition que nous laissions le reste des provisions que nous avions récemment reçues d'Ava.
"Il était midi avant que nous soyons autorisés à partir. Lorsque nous avons atteint Amarapora, M. Judson a été obligé de suivre les conseils du geôlier, qui l'a conduit au gouverneur de la ville. Après avoir fait toutes les recherches nécessaires, le gouverneur a nommé un autre garde, qui a conduit M. Judson au palais de justice d'Ava, où il est arrivé dans la nuit. J'ai suivi ma propre voie, je me suis procuré un bateau et j'ai atteint notre maison avant la nuit.
"Mon premier objectif le lendemain matin était de partir à la recherche de notre frère, et j'ai eu la mortification de le rencontrer à nouveau en prison, mais pas dans la prison de la mort. Je me rendis immédiatement chez mon vieil ami le gouverneur de la ville, qui était maintenant élevé au rang de Woon-gyee. Il m'informa que M. Judson devait être envoyé au camp birman pour servir de traducteur et d'interprète, et qu'il était mis en détention pour une courte période seulement, jusqu'à ce que ses affaires soient réglées. Tôt le lendemain matin, je suis retourné voir cet officier, qui m'a dit que M. Judson avait reçu à l'instant même vingt tickals du gouvernement, avec l'ordre de monter immédiatement à bord d'un bateau pour Maloun ; et qu'il lui avait donné la permission de s'arrêter quelques instants à la maison, qui se trouvait sur son chemin. Je me hâtai de retourner à la maison, où M. Judson arriva bientôt
; mais il ne fut autorisé à rester que peu de temps, le temps que je prépare de la nourriture et des vêtements pour un usage futur. Il fut entassé dans un petit bateau, où il n'avait pas assez de place pour s'allonger, et où son exposition aux nuits froides et humides le jeta dans une fièvre violente, qui avait presque mis fin à toutes ses souffrances. Il arriva le troisième jour à Maloun, où, malade comme il l'était, il fut obligé de se mettre immédiatement au travail de traduction. Il resta à Maloun six semaines, souffrant autant qu'en aucun temps de la prison, sauf qu'il n'était pas aux fers, ni exposé aux injures de ces cruels geôliers.
Pendant les quinze premiers jours qui suivirent son départ, mon anxiété fut moindre qu'elle ne l'avait été à aucun moment précédent, depuis le début de nos difficultés. Je savais que les officiers birmans du camp ressentiraient trop la valeur des services de M. Judson pour permettre qu'ils utilisent des mesures menaçant sa vie. Je pensais aussi que sa situation serait beaucoup plus confortable qu'elle ne l'était en réalité, et que mon anxiété était donc moindre.
Mais ma santé, qui n'avait jamais été rétablie depuis cette violente attaque à Oung-pen-la, déclinait de jour en jour, jusqu'à ce que je sois saisi de la fièvre boutonneuse, avec toutes les horreurs qui l'accompagnent. Je connaissais la nature de la fièvre dès le début et, vu l'état de 389
Le Livre des Martyrs de Foxe
ma constitution et le manque de personnel médical, j'ai conclu qu'elle devait être fatale. Le jour où j'ai été emmenée, une infirmière birmane est venue et a offert ses services pour Maria.
Cette circonstance me remplit de gratitude et de confiance en Dieu ; car, bien que j'eusse fait depuis si longtemps et si constamment des efforts pour me procurer une personne de ce genre, je n'avais jamais pu le faire ; alors qu'au moment même où j'en avais le plus besoin, et sans aucun effort, une offre volontaire me fut faite.
"Ma fièvre faisait rage violemment et sans aucun intermède. Je commençais à penser à régler mes affaires mondaines, et à confier ma chère petite Maria aux soins de la Portugaise, lorsque je perdis la raison, et fus insensible à tout ce qui m'entourait. C'est à cette terrible époque que le Dr Price fut libéré de prison et, apprenant ma maladie, il obtint la permission de venir me voir. Il m'a dit depuis que ma situation était la plus pénible qu'il ait jamais vue, et qu'il ne pensait pas alors que je survivrais de nombreuses heures. Mes cheveux étaient rasés, ma tête et mes pieds étaient couverts d'ampoules, et le Dr Price ordonna au serviteur bengali qui s'occupait de moi de tenter de me persuader de prendre un peu de nourriture, ce que je refusais obstinément depuis plusieurs jours. L'une des premières choses dont je me souviens, c'est d'avoir vu ce fidèle serviteur se tenir près de moi et essayer de me convaincre de prendre un peu de vin et d'eau. J'étais en fait si mal en point que les voisins birmans qui étaient venus me voir ont expiré en disant : "Elle est morte ; et si le roi des anges devait venir, il ne pourrait pas la guérir.
"J'ai compris par la suite que la fièvre avait duré dix-sept jours lorsque les ampoules ont été appliquées. Je commençai alors à me rétablir lentement, mais il fallut attendre plus d'un mois pour que j'aie la force de me tenir debout. Alors que j'étais dans cet état de faiblesse et d'affaiblissement, le serviteur qui avait suivi votre frère au camp birman est venu m'informer que son maître était arrivé et qu'on le conduisait au palais de justice de la ville. J'ai envoyé un Birman surveiller les mouvements du gouvernement et vérifier, si possible, de quelle manière on allait se débarrasser de M. Judson. Il revint bientôt avec la triste nouvelle qu'il avait vu M.
Judson sortir de la cour du palais, accompagné de deux ou trois Birmans qui le conduisirent à l'une des prisons, et que l'on avait appris en ville qu'il allait être renvoyé à la prison d'Oung-pen-la. J'étais trop faible pour supporter une quelconque mauvaise nouvelle, mais un choc aussi épouvantable que celui-ci m'a presque anéanti. Pendant quelque temps, j'eus du mal à respirer, mais je repris enfin assez de sang-froid pour dépêcher Moung Ing auprès de notre ami, le gouverneur de la porte nord, et le prier de faire un dernier effort pour la libération de M. Judson, et d'empêcher qu'on le renvoie à la prison de campagne, où je savais qu'il devait beaucoup souffrir, car je ne pouvais pas le suivre. Moung Ing partit alors à la recherche de M.
Judson ; il faisait presque nuit quand il le trouva à l'intérieur d'une obscure prison. J'avais envoyé de la nourriture au début de l'après-midi, mais comme je n'avais pu le trouver, le porteur était revenu avec, ce qui ajouta une nouvelle douleur à ma détresse, car je craignais qu'il ne soit déjà envoyé à Oung-pen-la.
390
Le Livre des Martyrs de Foxe
Si je n’ai jamais ressenti la valeur et l'efficacité de la prière, c'est à ce moment-là. Je ne pouvais pas me lever de mon lit ; je ne pouvais pas faire d'efforts pour obtenir mon mari ; je ne pouvais qu'implorer cet Être grand et puissant qui a dit : 'Invoquez-moi au jour de la détresse, et j'entendrai, et vous me glorifierez' ; et qui m'a fait sentir cette promesse si puissamment que je suis devenue tout à fait calme, étant assurée que mes prières seraient exaucées.
"Lorsque M. Judson fut envoyé de Maloun à Ava, ce fut avec un préavis de cinq minutes, et sans qu'il en connaisse la cause. En remontant la rivière, il a vu par hasard la communication faite au gouvernement à son sujet, qui était simplement la suivante : "Nous n'avons plus besoin de Yoodathan, nous le renvoyons donc à la ville d'or. En arrivant au palais de justice, il se trouve que personne ne connaissait M. J. Le président demanda de quel endroit il avait été envoyé à Maloun. On lui répondit qu'il venait de Oung-pen-la. Il fut alors remis à un garde et conduit à l'endroit susmentionné, où il devait rester jusqu'à ce qu'il puisse être transporté à Oung-pen-la. Pendant ce temps, le gouverneur de la porte nord présenta une requête à la haute cour de l'empire, s'offrit comme caution de M. Judson, obtint sa libération et l'emmena dans sa maison, où il le traita avec toute la gentillesse possible, et où je fus emmené dès que ma santé le permit.
C'est par une fraîche soirée de lune, au mois de mars, que, le cœur rempli de gratitude envers Dieu et débordant de joie à la vue de nos perspectives, nous descendîmes l'Irrawaddy, entourés de six ou huit bateaux dorés et accompagnés de tout ce que nous avions sur terre.
Pour la première fois depuis plus d'un an et demi, nous avions le sentiment d'être libres et de ne plus subir le joug oppressant des Birmans. Et avec quelles sensations de plaisir, le lendemain matin, j'aperçus les mâts du bateau à vapeur, présage certain d'être dans les limites de la vie civilisée. Dès que notre bateau a atteint la rive, le brigadier A. et un autre officier sont montés à bord, nous ont félicités de notre arrivée et nous ont invités à monter à bord du bateau à vapeur, où j'ai passé le reste de la journée, tandis que votre frère est allé à la rencontre du général qui, avec un détachement de l'armée, avait campé à Yandaboo, quelques kilomètres plus loin sur la rivière. M. Judson revint dans la soirée, avec une invitation de Sir Archibald à venir immédiatement dans ses quartiers, où je fus introduit le lendemain matin et reçu avec la plus grande gentillesse par le général, qui avait dressé une tente pour nous près de la sienne
- il nous prit à sa propre table et nous traita avec la gentillesse d'un père, plutôt que comme des étrangers d'un autre pays.
Pendant plusieurs jours, une seule idée m'a occupé l'esprit : nous étions hors du pouvoir du gouvernement birman et de nouveau sous la protection des Anglais. Nos sentiments nous dictaient continuellement des expressions comme celles-ci : Que devrons-nous rendre au Seigneur pour tous ses bienfaits à notre égard.
"Le traité de paix fut bientôt conclu, signé par les deux parties, et la fin des hostilités déclarée publiquement. Nous quittâmes Yandaboo, après une résidence de quinze jours, et 391
Le Livre des Martyrs de Foxe
atteignîmes sans encombre la maison de mission de Rangoon, après une absence de deux ans et trois mois."
Pendant toutes ces souffrances, le précieux manuscrit du Nouveau Testament birman a été gardé. Il a été mis dans un sac et transformé en un oreiller dur pour la prison du Dr Judson.
Pourtant, il était obligé d'être apparemment négligent à son égard, de peur que les Birmans ne pensent qu'il contenait quelque chose de précieux et ne l'emportent. Mais avec l'aide d'un fidèle converti birman, le manuscrit, représentant tant de longs jours de travail, fut gardé en sécurité.
À la fin de ce long et mélancolique récit, nous pouvons introduire de manière appropriée l'hommage suivant à la bienveillance et aux talents de Mme Judson, écrit par l'un des prisonniers anglais qui étaient enfermés à Ava avec M. Judson. Il a été publié dans un journal de Calcutta après la fin de la guerre :
"Mme Judson fut l'auteur de ces appels éloquents et énergiques au gouvernement qui les préparèrent par degrés à se soumettre à des conditions de paix, auxquelles personne ne s'attendait, connaissant la hauteur et la fierté inflexible de la cour birmane.
"À ce sujet, les débordements de sentiments de gratitude, en mon nom et au nom des autres prisonniers, m'obligent à ajouter un tribut de remerciements publics à cette femme aimable et humaine, qui, bien qu'habitant à une distance de deux milles de notre prison, sans aucun moyen de transport, et de santé très faible, oubliait son propre confort et son infirmité, et nous rendait visite presque chaque jour, cherchait et répondait à nos besoins, et contribuait de toutes les manières à soulager notre misère.
"Alors que le gouvernement nous laissait sans nourriture, elle a, avec une persévérance infatigable, par un moyen ou un autre, obtenu pour nous un approvisionnement constant.
"Lorsque l'état de nos vêtements en lambeaux témoignait de l'extrême de notre détresse, elle était toujours prête à reconstituer notre maigre garde-robe.
"Quand l'avarice insensible de nos gardiens nous confinait à l'intérieur, ou nous tenait les pieds dans les ceps, elle ne cessait, comme un ange tutélaire, d'adresser des requêtes au gouvernement, jusqu'à ce qu'elle fût autorisée à nous communiquer la nouvelle reconnaissante de notre élargissement, ou d'un répit dans nos oppressions pénibles.
"En plus de tout cela, c'est incontestablement grâce à l'éloquence répétée et aux appels percutants de Mme Judson que le Birman ignorant a finalement été disposé à assurer le bien-être et le bonheur de son pays par une paix sincère."
A la fin de ce long et mélancolique récit, nous pouvons introduire de manière appropriée l'hommage suivant à la bienveillance et aux talents de Mme Judson, écrit par l'un des prisonniers anglais, qui étaient enfermés à Ava avec M. Judson. Il a été publié dans un journal de Calcutta après la fin de la guerre :
392
Le Livre des Martyrs de Foxe
Mme Judson fut l'auteur de ces appels éloquents et énergiques au gouvernement qui les préparèrent par degrés à se soumettre à des conditions de paix, auxquelles personne ne s'attendait, connaissant la hauteur et la fierté inflexible de la cour birmane.
À ce sujet, les débordements de sentiments de gratitude, en mon nom et au nom des autres prisonniers, m'obligent à ajouter un tribut de remerciements publics à cette femme aimable et humaine, qui, bien qu'habitant à une distance de deux milles de notre prison, sans aucun moyen de transport, et de santé très faible, oubliait son propre confort et son infirmité, et nous rendait visite presque chaque jour, cherchait et répondait à nos besoins, et contribuait de toutes les manières à soulager notre misère.
Alors que le gouvernement nous laissait sans nourriture, elle a, avec une persévérance infatigable, par un moyen ou un autre, obtenu pour nous un approvisionnement constant.
"Lorsque l'état de nos vêtements en lambeaux témoignait de l'extrémisme de notre situation, elle s'efforçait de nous aider.
Les Débuts de la Mission
- 1800. Le premier converti de Carey est baptisé.
- 1804. Organisation de la Société biblique britannique et étrangère.
- 1805. Henry Martyn s'embarque pour l'Inde.
- 1807. Robert Morrison s'embarque pour la Chine.
- 1808. La réunion de Haystack se tient près du Williams College.
- 1810. Organisation de l'American Board.
- 1811. Les Wesleyens fondent la mission de Sierra Leone.
- 1812. Les premiers missionnaires de l'American Board prennent la mer.
- 1816. Organisation de la Société biblique américaine.
- 1816. Robert Moffat s'embarque pour l'Afrique du Sud.
- 1818. La London Missionary Society entre à Madagascar.
- 1819. Organisation de la Methodist Missionary Society.
- 1819. L'American Board ouvre la mission des îles Sandwich.
- 1819. Judson baptise le premier converti birman.
393

Le Livre des Martyrs de Foxe